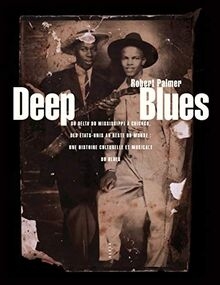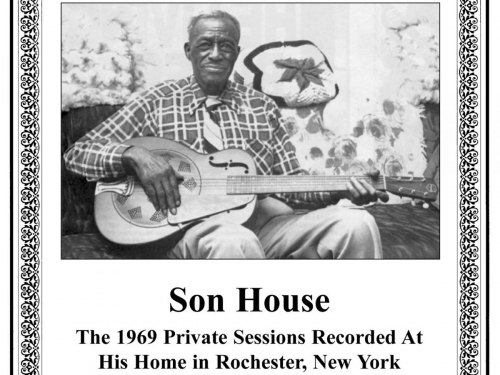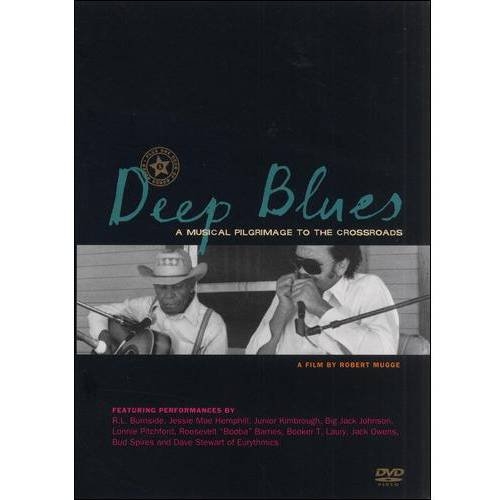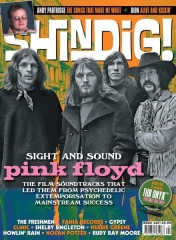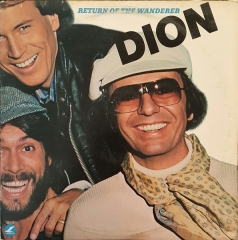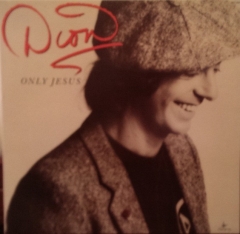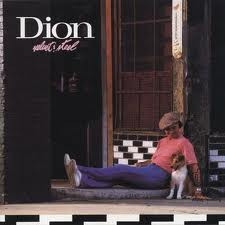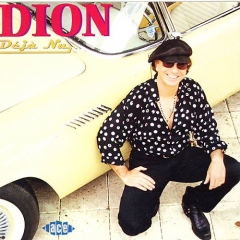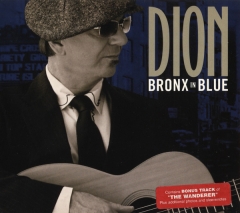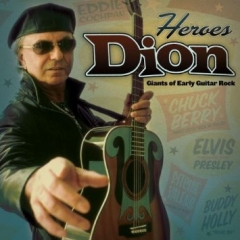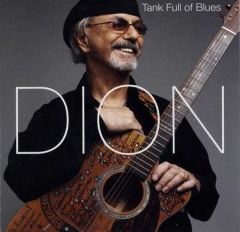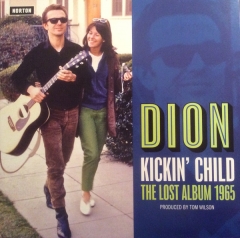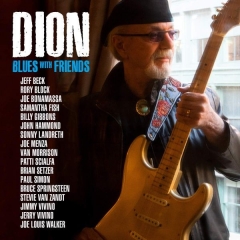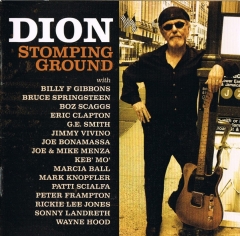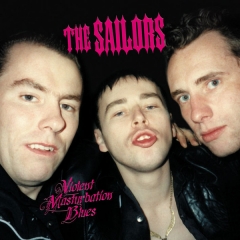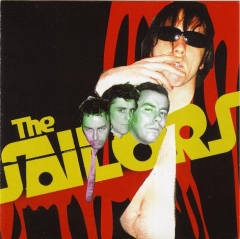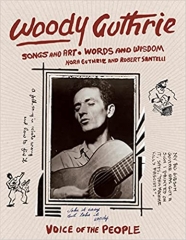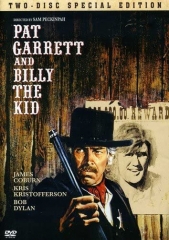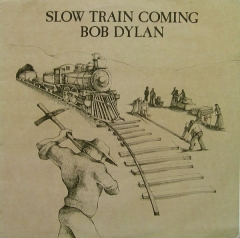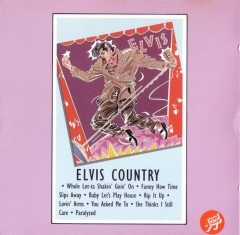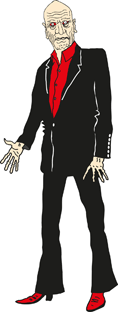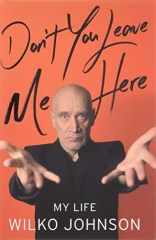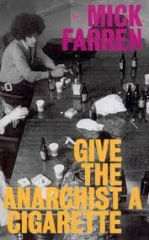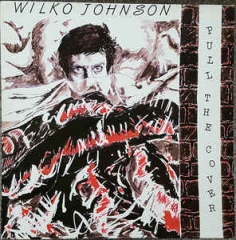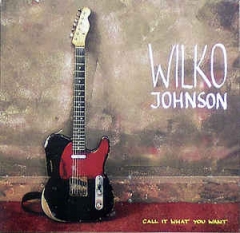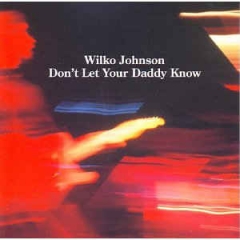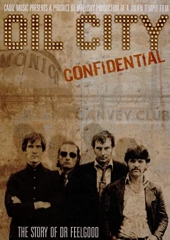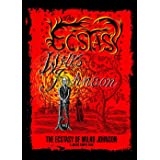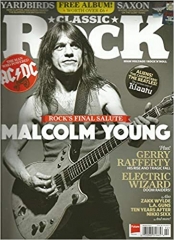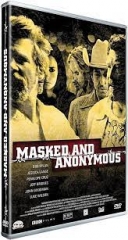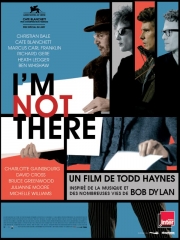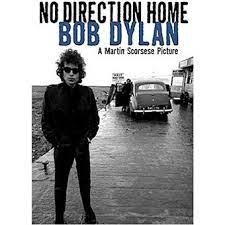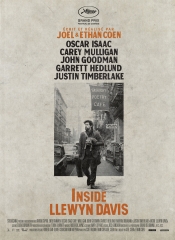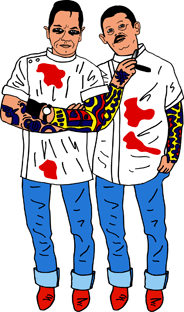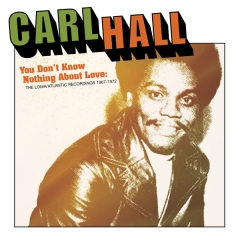KR'TNT !
KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 549
A ROCKLIT PRODUCTION
SINCE 2009
FB : KR’TNT KR’TNT
07 / 04 / 2022
ROCKABILLY GENERATION NEWS
BOBBY GILLESPIE + PRIMAL SCREAM
PROCOL HARUM / ENDLESS BOOGIE
BABY LOVE / BOB DYLAN / GOATGOD
JIM MORRISON + MARIE DESJARDINS
Sur ce site : livraisons 318 – 549
Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :
ROCKABILLY GENERATION NEWS N° 21
AVRIL / MAI / JUIN 2022
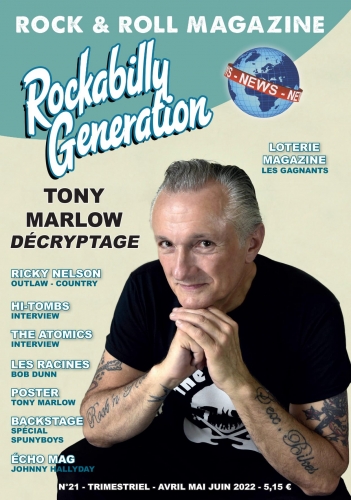
En avril ne te découvre pas d’un fil. Est-il vraiment obligatoire de préciser électrique. Pour cette vingt-et-unième livraison Rockabilly Generation s’est branché en triphasé, z’ont même éliminé la Terre qui normalement permet d’évacuer le surplus d’énergie, c’est un peu plus dangereux mais le rock’n’roll n’est pas une musique pépère. Donc on frôle la perfection. Sans attente plongeons sans ménagement nos doigts humides d’impatience dans le boîtier, sans même accorder ( pour le moment ) un regard à l’effigie du couvercle.
Greg Cattez nous présente Ricky Nelson. Peut-être le premier pionnier que j’ai vu dans mon enfance. Dans Rio Bravo, avec John Wayne, m’en souviendrai toujours, surtout du shoot d’Izarra verte, un plein verre que m’avait généreusement servi Jeannot un ami de mes parents qui nous avait invité voir le film à la télé. C’est cela le rock ‘n’roll, y a toujours d’autres trucs plus ou moins raides et voluptueux qui traînent avec. Mais revenons à Ricky. L’est pas mort comme l’amiral Nelson sur son bateau mais dans son avion qu’il avait racheté à Jerry Lou. Un étrange destin, un de ces enfants stars que les chaînes américaines s’arrachaient. Un feuilleton familial un peu gnan-gnan grand public. Tout pour ne pas devenir un rebelle. Oui mais piqué à quinze ans par la tarentule Elvis Presley il décide de devenir chanteur de rock. Le pire c’est qu’avec l’aide de papa, il réalise son rêve. Pas riquiqui en ses débuts le Ricky, malgré sa gueule d’ange propre sur lui l’a quand même Joe Maphis et James Burton sur ses premiers disques. En France l’a été un peu boudé par les premiers rockers, mais depuis sa cote est bien remontée… Greg Cattez raconte la légende, on écoute et on rêve, mieux que les photos d’archives qui l’accompagnent l’on s’attarde sur la pleine page de quarante-deux disques de sa discographie.
Y a pas que les amerloques qui rockent. Les néerlandais aussi. A part que le guitariste des Hi- Tombs est français. Fredo Minic est né à Issy-Les-Moulineaux. Raconte son histoire, le parcours classique, un premier groupe de copains et la montée en puissance au fil des années. Ne se prend pas pour un cador, reste humble, longtemps rythmique avant d’être lead, n’a pas l’envie de surpasser les devanciers, il apprend, il travaille, mais l’a une forte personnalité, les échecs ne l’arrêtent pas, si un groupe se débande il en projette tout de suite un autre, trouve enfin en 2007 la formule avec Hi-Tombs, une des formations de stature européenne du paysage rockabilly actuel… L’a un secret, ne fait pas de concession. Y a pas que les amerloques qui ont des pionniers à la toque. Certes on en a moins, mais on a Tony Marlow. Et à lui tout seul il en vaut trois ou quatre. Zieutez ses yeux malicieux et son regard de velours sur la couve. Pas moins de quatorze pages pour résumer sa vie ès rock ‘n’roll. L’a dû naître l’année du chat car il a déjà vécu une quinzaine de vies rock ‘n’roll. Une existence au service du rock ‘n’ roll et que serait le rock français s’il n’y avait pas Marlow le marlou. L’est le témoin, l’est le passeur et surtout l’est le novateur. L’a tout vu, tout connu, tout embrassé. Toujours un coup en avance, toujours là où ne l’attend pas. Toujours fidèle à lui-même. Quelle que soit la formule qu’il adopte il tient la route, ne négocie pas ses virages, mais trouve immanquablement son public. Sa discographie est une revisitation du l’histoire du rock depuis le swing, les pionniers, l’early french sixties, le revival rockabilly, le son anglais, le psyché, le punk ‘n’ roll avec Alicia F… à la batterie, à la guitare, au chant, à la compo, à l’écriture. En anglais, en français et même en corse… Il y a quarante ans que cela dure, le Marlow-rock a la vie dure ! Rassurez-vous, ce n’est pas fini.
Parfois n’y a que les amerloques qui ont le bidule dans la bicoque. L’on s’est mis à deux pour vérifier. Un article bien écrit de Julien Bollinger qui inaugure la nouvelle rubrique : Racines. Inconnus au bataillon. Oui ils sont deux, l’auteur et Bob Dunn. Avec Mister B, le copain, l’on est allé illico annihiler notre ignorance ( honteuse ) sur You Tube, imitez-nous, tout ce que raconte Julien est vrai, Ce Bob Dunn est le premier à avoir traficoté sa guitare pour l’électrifier, un sacré bricolo, mais ce n’est peut-être pas le plus important, le fameux Crossroad de Robert Johnson c’est lui, sidérant, une vidéo de vingt minutes Bob Dunn’s Vagabonds Steel guitar 7 songs 1939. Un feu d’artifice. Le passage du blues au country, la gestation du boogie, la concomitance avec Django Reinhart, et bien d’autres encore, prêtez l’oreille, les plans se suivent et ne se ressemblent pas. Un trésor, une découverte. En plus Bob Dunn aimait beaucoup cette Izarra jaune que les américains appellent whisky.
Là, les amerloques peuvent aller se cuire un œuf à la coque. Ce numéro de Rockabilly Generation ne sera pas terminé avant que le coq français n'aura pas chanté trois fois. Tout comme pour Tony Marlow, Kr’tnt a souvent présenté The Atomics en concerts. Peu de disques, n’ont enregistré sous leur propre nom qu’un EP de quatre titres. L’on écoute parler Raph, le guitariste, un de mes préférés, très électrique, dans ses mots défile toute l’histoire du rockabilly français cette génération boostée par l’apparition de Brian Setzer, qui se perpétue et résiste sans faille, constituant l’épine dorsale du public rock national. L’on retrouve chez Raph cet amour invétéré pour les pionniers et cette modestie consubstantielle qui caractérise la majeure partie des musiciens de rockabilly. Pas de frime, des actes, une obstination et une persévérance qui éblouissent.
Suivent les chroniques habituelles, nouveautés, concerts, un backstage consacré aux Spunyboys, deux annonces, une qui serre le cœur, Help for the Wise Guys in Ukraine, et Dans la chaleur de Johnny une boutique spécialisée dans des objets Johnny Hallyday, tenue par un fan Cédric, et sise Rue Magenta à Epernay ( 51 ).
Superbe numéro. L’aventure Rockabilly Generation menée de main de maître par Sergio Kazh continue. Papier glacé, mise en page attrayante, documents d’archives, des interviews qui libèrent la parole, et des photos à vous arracher les yeux. C’est Sergio Kazh le coupable.
Damie Chad.
Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 5,15 Euros + 4,00 de frais de port soit 9, 15 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 37, 12 Euros ( Port Compris ), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( cochez : Envoyer de l'argent à des proches ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de toutes les revues... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents !
Baby Gillespie
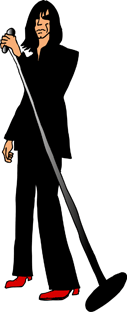
Quand on voit la photo de Bobby Gillespie qui orne la jaquette de Tenement Kid, son autobio récemment parue, on comprend tout. Enfin, c’est une façon de parler. On comprend surtout que Bobby est un éternel adolescent, ce que confirme l’écoute des albums de Primal Scream. Sa voix n’a jamais mué. Il est resté le Baby Gillespie de son adolescence, tel qu’on le voit, là, sur cette photo, en train de chevaucher une petite moto de ville. On serait presque tenté de penser qu’il est un vampire, au même titre que Jean-Michel Jarre qu’on croisait à une époque sur les bords de Seine, sidérant de jeunesse éternelle. Baby Gillespie aurait très bien pu jouer le rôle d’Adam dans l’excellent Only Lovers Left Alive de Jim Jarmush, un film nocturne qui nous emmène sur les traces de Brian Jones à Tanger, quand bien même le pauvre Brian Jones n’est pas un vampire, comme on sait. Par contre, on a vu en 2020 un Baby Gillespie sidérant lui aussi de jeunesse éternelle danser comme un vampire lors du tribute à Rowland S. Howard à la Maroquiqui, et si on examine la petite photo qui se trouve sur le rabat de jaquette en troisième de couve, on se voit contraint d’admettre que Baby Gillespie n’a pris aucune ride en quarante ans. On remarque juste l’éclat noir de son regard, qui est bien sûr l’apanage des vampires. N’allez surtout pas croire que la condition du vampire est un privilège. Il en va du fil des siècles comme du fil des ans, on finit par en avoir vraiment marre. Ce qu’a très bien compris Jarmush, puisqu’il fait mourir, oui, mourir, Marlowe, le vieux vampire que joue John Hurt dans son film. Ras le bol de l’éternité. Seul un vampire supérieurement intelligent peut comprendre ça.
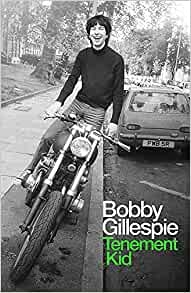
Ce book vaut le temps qu’on lui consacre pour deux raisons principales : Baby Gillespie y narre une éducation musicale parfaite, et d’autre part, il nous narre l’histoire des Mary Chain telle qu’on a toujours rêvé de la lire, racontée de l’intérieur, du temps où Baby G battait le beurre pour les frères Reid.

Si Flaubert avait grandi en Écosse au XXe siècle, il aurait pu écrire Tenement Kid sur le modèle de l’Éducation Sentimentale. Non pas que Baby G soit un grand écrivain, mais il donne beaucoup d’allure à ses convictions, d’autant plus d’allure qu’il grandit dans un milieu pauvre et fortement politisé. Il dit sa fascination pour Fidel et le Che qui ont viré les Américains et la mafia de Cuba. Il va même jusqu’à prétendre, et il a raison, que Fidel et le Che ont démarré les sixties trois ans avant les Beatles. On a tous eu des posters du Che dans nos chambres. Rien de surprenant à cela, le Che arborait non seulement une allure de rockstar, mais il agissait en plus comme un héros - Che was our Jesus, a rockstar revolutionary - Baby G ajoute que Dennis Hopper avait basé son look sur le Che. Small Baby G admire aussi Cassius Clay parce qu’il refuse d’aller se battre au Vietnam en balançant dans la barbe du pouvoir néo-nazi américain : «No Viet Cong ever called me a nigger !». Small Baby G admire donc les sportifs noirs, Cassius Clay et Pelé - Sport is an incredible way of breaking down racial préjudice - Mais en même temps, il se dit consumé de l’intérieur, par une douleur à la fois psychique et spirituelle. Il est convaincu pendant toute son enfance que la vie n’est que confrontation, compromis et violence. Les rues de Glasgow ne sont pas sûres à l’époque. Il se fait souvent casser la gueule et doit apprendre à se défendre ou à raser les murs. Quand il arrive à l’école primaire de Mount Florida en 1972, un kid lui dit : «Tu es au courant pour Skin des Tiki ? Il a reçu un coup de hache dans le dos hier soir.» Les Tiki sont le gang local - Everywhere you went in Glasgow there were gangs - Baby G rappelle les principes de base de la vie d’ado à Glasgow : tu dois être dur - it was all about how hard you were - et plus tu es dingue, plus tu es respecté. Sinon, évite de faire le cake et de te faire remarquer car tu vas recevoir une grosse branlée. Et un peu plus loin, il amène une conclusion qui tombe sous le sens - So when punk came along, I was just ready for it - En 1976, il a 14 ans et encore toutes ses dents.

Bien que ses parents soient d’une extrême pauvreté - la famille habite dans un deux pièces, le fameux tenement, c’est-à-dire le taudis - ils écoutent des disques. Et pas n’importe quels disques. Certainement pas Chantal Goya. Baby G se souvient très bien d’un Greatest Hits de Diana Ross & the Supremes sur Motown. Le chouchou de Dad, c’est Muddy Waters avec «I Got My Mojo Working». Il y a aussi le Greatest Hits Volume 2 de Ray Charles «on the stateside label with a cool photo of Ray. Dad would play this record A LOT.» Ils écoutent aussi Bob Dylan - Dad loved The Times They Are A-Changing LP with all the protest songs on it - Mum adore Hank Williams, «Moaning The Blues» which she played A LOT. Elle adore aussi Doris Day et un single d’Elvis que Baby G passe son temps à admirer, thinking how beautiful he looked. Il se souvient aussi d’un live de Smokey Robinson au dos duquel Dylan disait de Smokey qu’il était «America’s greatest living poet». Baby G indique aussi qu’il n’y avait pas de disques des Beatles in the house - Mum later told me she never liked them; she preferred the Stones - Comme ça au moins les choses sont claires. On ne sera pas obligé de lui demander s’il préfère les Stones ou les Beatles.

Il se souvient de la teuf-teuf familiale qu’ils avaient dans les early seventies : une beautiful dark green Vauxhall Viva, équipée d’un lecteur de cassettes et Dad écoutait Bridge Over Troubled Waters et Glen Campbell - That’s when I first heard the Rolling Stones, in that car - À 11 ans, il flashe comme tous les kids d’Angleterre sur Marc Bolan, il appelle ça du bluesy hard rock, puis un copain d’école lui passe Aladdin Sane, et il est frappé par le portrait de Bowie à l’intérieur du gatefold, «à la fois satyre, mi-homme mi-bête, de sexe indéterminé» - It was a totally mind-blowing image - Ça lui tournicote les hormones. Puis il découvre tout le glam à la téloche, dans Top Of The Pops, Sweet, Roy Wood and Wizzard, Gary Glitter, Slade, Mott The Hoople, Bowie, Sparks et T. Rex - Bowie and Bolan introduced me to androginy an poetry - C’est le parcours classique d’un kid qui grandit dans les seventies. Il existe énormément de points communs entre cette autobio et celle de Kris Needs. Puis c’est la révélation : une petite photo de Johnny Rotten - My first outsider hero. No words needed - Puis ça continue avec Diamond Dog, le Slaughter On 10th Avenue de Mick Ronson et le 16 And Savaged de Silverhead. Le premier single qu’il achète avec son argent de poche est l’«Hellraiser» de Sweet. Puis chez le copain Butchie, il découvre Meaty Beaty Big And Bouncy des Who, ainsi que Who’s Next et Live At Leed, le Get Yer Ya-Ya’s Out des Stones, puis il flashe sur le Stupidity de Doctor Feelgood, sur Nazareth, sur «Motor-Biking» de Chris Spedding, quelques singles de Status Quo et le Machine Head de Deep Purple - Rock and roll totally consumed me. It became my religion - Il voit la culture rock comme un espace de liberté, où les gens peuvent devenir eux-mêmes. Il finit par découvrir que c’est aussi un moyen de se réinventer. L’imagination au pouvoir, en quelque sorte. C’est exactement ça, Baby G. Il a tout compris. Il veut échapper au monde réel qui ne lui plaît pas - I think punk did that for me - Il pense même, comme beaucoup de gens qui ont suivi le même chemin, que le rock lui a sauvé la vie. Vers la fin du book, il évoque les blues people qui sont à ses yeux the ultimate outsiders - Soul and country are both artforms created by working-class Americans, Black and white - C’est parce que petit il écoutait Ray Charles (Dad) et Hank Williams (Mum) qu’il a ça en lui, a deep love of the blues. Dans les années 90, il passe son temps à écouter ce qu’il appelle des «albums sérieux», ceux des masters; sixties and seventies soul songwriters, the country soul guys comme Dan Penn, Donnie Fritts et Kris Kristofferson. Grown-up, adult songwriters. Serious guys with a life story. Literary songwriting. Songs of experience, à la différence de ses chansons qui sont des songs of innocence. Il veut écrire des songs of experience, lui Baby G, l’éternel adolescent ? Ha ha ha, quelle blague ! Éducation parfaite. Baby G est ce qu’on appelle un gosse rudement bien élevé.
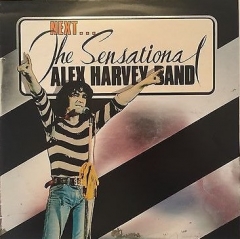
Il nous fait aussi des pages superbes sur Alex Harvey Band et Thin Lizzy. Alex Harvey parce que c’est un mec de Glasgow et tous les copains d’école ont un patch SAHB (Sensational Alex Harvey Band) cousu sur leur blouson Wrangler - Harvey was one of our own, a Glasgow boy qui avait réussi après des années d’efforts. Son Sensational Band portait bien son nom. They took no prisoners and stormed the nation’s pop charts and concert venues with a mixture of street-sharp hard rock, sea shanties, murder ballads and Weimar decadence - Baby G flashe sur l’album Next, avec Alex les bras en l’air sur la pochette et cette invitation à se battre, «Come ahead, your tea’s out !», Baby G voit Alex comme «the shamanic pagan high priest, comme Richard Wagner fronting a rock band». Il se demande comment un mec aussi pauvre a fait pour réussir à devenir célèbre - He was just a guy from the same streets as me, from Tradeston - Et ça repart de plus belle avec Thin Lizzy et «The Boys Are Back In Town», la chanson qui pour Baby G définit le mieux l’été 1976, l’été de ses 14 ans. Il voit Lizzy à Top Of The Pops et il est frappé par l’«extremely handsome black Irishman dressed in tight blue jeans, stack-heeled shoes and a loose-fitting glammed-out silver-streaked cowboy shirt unbuttoned halfway down his chest, revealing a silver necklace. He wore his hair in the afro style, tight like Jimi Hendrix. He was just so confident and outrageously flash.» What a portrait ! Baby G a du pif, il choisit les bonnes idoles. Quand il voit dans le journal local que Thin Lizzy passe à l’Apollo Theatre de Glasgow, il décide d’y aller avec un gosse du quartier qu’il ne connaît que de vue, Alan McGee. En trottinette, ça fait trop loin, alors ils y vont tous les deux en autobus. Pour Baby G, c’est le dépucelage - I lost my rock and roll virginity to Phil Lynott and Thin Lizzy that night. I was filled with the Holy Spirit of Rock and Roll, never to be the same again. The classic line-up of Lynott, Downey, Gorham and Robertson transmogrified my teenage soul with raw-powered street rock and flash glam electric sexuality. My love for Lizzy will never die. They were the first real musical love that I discovered by myself and they still inspire me to this day. Phil was the greatest, a true working-class hero. Every boy wanted to be him, every girl wanted to fuck him - Et soudain le punk arrive.

Baby G commence par tomber sur les Damned à la télé. Nest Neat Neat ! Boom badaboom ! Il tombe de sa chaise. Puis à Pâques 1977, il achète le NME avec les Clash en couve. Les trois Clash, avec Simonon au milieu ! Oh la la ! Il est choqué par leur brutally short hair, car «in early 77, tout le monde a les cheveux longs». Il achète l’album des Clash et rentre chez lui en courant pour l’écouter sur la stéréo de ses parents qui sont au boulot. Il met le volume à fond, cranking up the volume full blast. Comme tous les kids de son âge, Baby G est ratatiné par cet album, c’est un phénomène purement britannique. Puis il achète «God Save The Queen» et rentre chez lui en courant pour l’écouter avec son petit frère Graham - We were just ORGASMING - Ils expérimentent tous les deux ce qu’il appelle le psychic jailbreak, l’évasion psychique. Leur vision du monde change ce jour-là, avec le full blast des Pistols. Puis il découvre les Dolls. Quoi, des mecs qui sonnent comme les Pistols ? Ce n’est qu’un plus tard qu’il comprendra que les Dolls étaient là avant et qu’ils sont devenus les Heartbreakers. Baby G commence à hanter les disquaires de Glasgow, il y en a six à proximité du lycée et celui qu’il préfère s’appelle Bloggs car il vend du punk et le vendeur n’est autre que Mickey Rooney, futur chanteur des mighty Primevals - A Stooges and MC5 fanatic - Baby G se lance comme tout le monde dans l’achat de disques américains, avec «Sheena Is A Punk Rocker» des Ramones et «Spanish Stroll» de Mink DeVille, puis il continue avec Patti Smith, Richard Hell, les Runaways et les Dead Boys. Mais son chouchou reste Johnny Rotten - Everything he said in the interviews was deeply confrontational and launched with a fusillade of hate - Baby G n’en finit plus de l’admirer, d’autant plus qu’il n’avait rien d’un sex-symbol à la Rod Stewart - He was exactly like one of us working-class street kids - Les Pistols renversent l’échelle des valeurs, tout ce qui était joli devient laid et tout ce qui est laid devient joli. Oh et puis les fringues - Black leather trousers and jackboots, Mod bum-freeze jacket and Destroy shirt, the studded wristband, S&M belt and his digital watch. I thought he was the coolest-looking guy in the world - Quand Johnny Rotten se pointe sur Radio One, John Tobler lui demande ce qu’il écoute, et Rotten lui répond : «Football chants and Irish rebel songs.» Alors Baby G est sidéré : «I thought, that’s me !», oui, car il va voir les matches de foot et chante les football chants and Irish rebel songs at Celtic games... and he is in the best rock and roll band in the world. Johnny Rotten comes from a council estate, so I do. THIS GUY’S LIKE US !
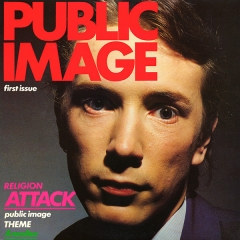
En 1977, Baby G casse sa tirelire pour aller voir des concerts : Lizzy deux fois, Graham Parker And The Rumour, Status Quo, the Jam, the Damned, Dead Boys, the Clash et ça se termine avec that amazing Christmas show : Ramones supported by the Rezillos. Il tombe sous le charme des Ramones, comme tout le monde - Ramones were perfect in both charm and vision. Ramones were a total assault on the senses. Ramones were godhead - Et quand après la fin des Pistols, John Lydon revient avec PIL, Baby G en bave d’admiration, parce que justement, Lydon ne revient pas avec des nouveaux Pistols, mais avec un son nouveau - We’d never heard anything like this before - Il faut bien se souvenir que PIL fut révolutionnaire à l’époque. Du coup, Baby G se sent encore plus proche de son idole - He was my guiding star - Il va ensuite flasher sur Ian McCulloch qui selon lui a tout, the looks, the hair, the voice - The Bunnymen had a mystique - Puis il devient roadie pour Altered Images qu’il trouve really good.

En 1978, il commence comme tout le monde à écouter le John Peel Show on Radio One sur un petit transistor à piles, du lundi au jeudi. Puis grâce à Zigzag, il découvre Love, les Byrds, les Doors, Buffalo Springfield, Tim Hardin et Tim Buckley. Small Baby G ne sait plus où donner de la tête. Et puis il y a Johnny Thunders en couverture de Zigzag, avec à l’intérieur son interview par Kris Needs pour la promo de So Alone. Ah la longueur des filets de bave ! Et comme tout le monde, Baby G se met à acheter chaque semaine la trilogie impérative, NME, Melody Maker et Sounds. De quoi devenir dingue.

Un soir, lors d’une party chez Severin à West Hampstead, Baby G tombe sur sa collection de disques. Il est choqué d’y voir trôner l’Electric Ladyland, non pas à cause des gonzesses à poil sur la pochette - Baby G ne bande pas encore - mais parce que l’album était à l’époque considéré comme un hippy album, et donc mal vu chez les punks - That’s how it was in those days - Il se souvient aussi d’avoir réagi de la même façon en découvrant le White Album chez Andrew Innes, qui est alors un copain du quartier - It was a crime to admit you liked anything before 1976 except for the Velvet Underground, Iggy and the Stooges, New York Dolls and MC5 - C’est vrai que le sectarisme régnait sans partage, surtout à cette époque. Tout le monde devenait à moitié con avec le punk-rock. On lançait des anathèmes à tout bout de champ. Fuck ci, fuck ça. Si Can et Van Der Graaf échappaient aux purges, c’était grâce à Johnny Rotten qui en disait le plus grand bien à la radio.
Et comme tout le monde, Baby G s’achète une première guitare électrique, une copie de Les Paul Classic, «a cherry-burst reddish-brown colour, very Thin Lizzy» et un ampli Peavy Bandit. La première chose qu’il apprend à jouer dessus, c’est «Time’s Up» et le solo sur deux notes du «Boredom» des Buzzcocks. Puis il s’achète une basse, «a black Fender Mustang bass guitar and an Electro-Harmonix Clone Thenry effects pedal». Il adore jouer comme Jah Wobble de PIL.

Il revient longuement sur l’autre grande idole de son enfance, Jimbo, un Jimbo héroïque qui traite le public de Miami de bande d’esclaves. Baby G et son frangin Graham adorent rouler la nuit dans Glasgow, au volant de Mum’s little Renault, en écoutant une cassette des Doors, la compile de singles qui s’intitule 13 - Five to one baby/ One in five - Baby G admire autant Jimbo que le Che : «Jim Morrison vivait réellement les choses qu’il chantait. In the future I would personnaly find that was a very dangerous game to play.»
Il se met à vénérer les auteurs comme Jagger & Richards, Jim Morrison, Lou Reed, Ray Davies et Iggy Pop. Son copain Beattie avec lequel il va démarrer Primal Scream s’achète une douze pour sonner comme les Byrds - He was hooked on Roger McGuinn’s jingle-jangle magic Rickenbacker guitar sound - Alors Baby G s’achète une «sky-blue Vox Pantom as played my hero Sterling Morrison, guitariste extraordinaire of the Velvet Underground.» Et puis en 1984, le punk passe de mode - It was seen as an embarassment in the UK music papers - Et les hip people de Glasgow étaient tous des clones de Bowie Young Americans, dans leurs fringues atroces, playing the white-boy funk that was as funky as Margaret and Dennis Thatcher attempting to dance the Funky Chicken: naff central - Eh oui, les années 80. Comme tout le monde, Baby G se réfugie dans les «ultra-damaged poster-boys of underground rock», Syd Barrett et d’autres misterioso figures comme Arthur Lee, Brian Wilson et Alex Chilton - Not a lot of people were interested in these artists. They were seen as sixties drug casualties and burnouts, embarassments from another era - Puis comme tout le monde, Baby G part à la chasse aux disques dans les record fairs, il ramasse de tout, Electric Prunes, Eddie Floyd, Isaac Hayes, des Stax singles, 13th Floor Elevators, Byrds, Misunderstood, puis c’est le déluge des compiles fatales, Perfumed Garden, Acid Dreams, tout le bazar de Rhino puis de Line Records en Allemagne qui se met à rééditer tout ce qui peut intéresser les kids boulimiques comme Baby G. En 1984, il ne jure que par ses psychedelic heroes Jim Morrison, Lux Interior, Roky Erickson, Syd Barrett et Arthur Lee. Et pour entrer en osmose avec le psychédélisme, il faut bien sûr prendre des psychedelic drugs, otherwise you can’t be psychedelic ! Logique imparable.
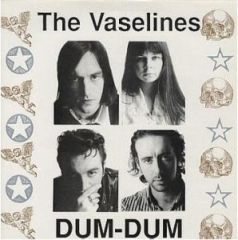
Il évoque brièvement la scène de Glasgow, Teenage Fanclub, les Vaselines qu’admirait tant Kurt Cobain, et Stephen Pastel - He was a freaky kid, total outsider in his own way - mais qui choque Baby G car il lui dit ne pas aimer les Pistols. Baby G lui demande pourquoi et Stephen Pastel lui répond : «They’re like heavy metal.» À quoi Baby G ajoute : «Stephen was more into Dan Treacy, TV Personalities and Swell Maps. We agreed on the Shangri-Las, Velvet and Subway Sect though.» Baby G ajoute que Stephen est toujours d’actu à Glasgow et qu’il possède a fantastic record shop called Monorail. Baby G évoque aussi Mark E. Smith qu’il admire, comme tout le monde, et Prince plus encore, surtout les singles parus dans les années 80 - They’re as good as the Beatles or the Stones, Bowie, Phil Spector, Tamla-Motown, Stax, anyone - À tel point qu’il le veut comme producteur du premier album de Primal Scream, ce qui fait marrer McGee. À la place de Prince, il obtient Stephen Street.
Quand dans les années 80, Baby G s’installe à Brighton, il ouvre avec ses copains un club nommé SLUT. Sur le poster du club figure le fameux portrait de Brian Jones en uniforme nazi, avec comme légende le fameux ‘Stay sick Turn blue’ emprunté aux Cramps et qu’on trouve, précise Baby G, au dos de leur premier single, «Human Fly» on the Vengeance label. Des groupes viennent jouer au SLUT : Strawberry Switchblade, Felt, Loop and Weather Prophets, des groupes dont il est fan, surtout Loop - We loved Loop - Faut pas louper Loop. Puis il tombe dans les bras de Bobby Blue Bland - noir-pop-bed-chamber blues and adult existentialism - et du great O.V. Wright - His classic records are occult Mississippi Delta alchemical conjurings made under the guidance of the great producer Willie Mitchell - Il explore les labyrinthes de cette Soul, espérant qu’un jour I could emulate it. Mais pour chanter comme O.V. et Bobby Blue, il faut muer, Baby G, et il ne mue toujours pas. Il évoque aussi les fameuses compiles Northern Soul sur Kent et les Ady Croasdell’s soul nights au 100 Club dont Andrew Innes est un habitué. Il va voir les Spacemen 3 en concert, car il aime bien le single «Revolution», mais quand il entre dans la salle, il en reste comme deux ronds de flan : au pied de la scène, les kids sont assis par terre comme des hippies, et les Spacemen sont eux aussi assis, le cul dans des chaises. Incroyable ! Il découvre plus tard qu’ils sont des smackheads, alors pour lui, ça tombe sous le sens.

Ce sont surtout ses paragraphes politiques qui rendent Baby G infiniment sympathique. Il nous raconte mieux que quiconque l’écroulement de la classe ouvrière anglaise. Le foot sert à cristalliser la colère, d’où la violence dans les stades. Il sait que la classe ouvrière n’existe que pour travailler dans les mines et les usines qui sont la propriété des bourgeois, cette sale race qui fait des profits obscènes sur le dos des travailleurs, Baby G n’y va pas de main morte, il développe bien cet aspect des choses, car la rage politique est directement liée au rock, il parle de siècles de féodalisme dégradant et des horreurs de la révolution industrielle qui, c’est vrai, a battu tous les records en Angleterre. Et voilà que Baby G se retrouve sur le marché du travail, à l’aube de la post-industrialisation. Comme tout le monde, Baby G voit que les lois votées au parlement sont des actes de violence dirigés contre les plus pauvres, il cite des fameux plans d’austérité alors qu’on allégeait les impôts des plus riches, Baby G en écume de rage, il sait que la pauvreté tue et il voit la femme la plus détestée d’Angleterre, la mère Thatcher, écrabouiller les mineurs, elle a enfanté nous dit Baby G des créatures aussi politiquement ignobles qu’elle et il balance les blazes de Blair et de tous ceux qui ont suivi, all are Thatcher’s children and I hate them all equally. But I hate her more. She was their Elvis - Plus loin, il tombe à bras raccourcis sur Queen, Elton John et Rod The Mod qui sont allés jouer en Afrique du Sud, au temps de l’apartheid - They had all taken the apartheid gold - Il a raison de s’énerver, Baby G, ces comportements sont impardonnables. Il développe ainsi son radicalisme à longueur de pages et c’est une dimension d’autant plus capitale qu’elle n’apparaît jamais dans la presse rock, connue pour son édifiante superficialité. Le rock et la contestation politique sont issus du même principe de refus de l’autorité, et dans le cas de l’Angleterre, du despotisme libéral, qui est sans doute le pire fléau du XXIe siècle. La notion de profit n’a jamais autant fait de ravages dans les cervelles. Il faut désormais s’habituer à l’idée qu’un monde meilleur n’existera jamais.
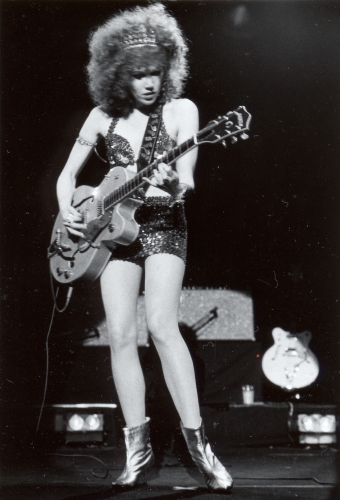
Baby G cite souvent les Cramps sans jamais vraiment en parler. Il fait juste des petites allusions de temps en temps, comme s’il en avait la trouille et qu’il n’osait pas s’en approcher. Lors d’une fête sauvage dans une usine abandonné avec les frères Reid, Baby G dit entendre le «Caveman» des Cramps. Il rencontre à une époque un nommé Joogs qui est fan des Cramps. Joogs jouera du tambourin dans la première mouture de Primal Scream. Lors de son premier voyage à Los Angeles, Baby G croise sa guitar heroin Poison Ivy Rorschach chez un disquaire. Il est tellement intimidé qu’il n’arrive pas à parler - Ivy was so fucking sexy. The queen of rock and roll - D’ailleurs, quand il compose «Ivy Ivy Ivy» pour le deuxième album de Primal Scream, il pense bien sûr à Ivy Rorschach of the Cramps. Et sur scène, avec Primal Scream, ils jouent en rappel «Up On The Roof» by Carole King and «Lonesome Town» by Ricky Nelson and the Cramps.

Quand on bénéficie d’une telle éducation, on finit fatalement par mal tourner, c’est-à-dire jouer dans un groupe. Baby G a déjà commencé à acheter des guitares, à prendre des drogues et à composer des chansons. Alors il monte Primal Scream avec le copain Beattie. Le nom du groupe sort d’un texte de Mark E. Smith sur Live At The Witch Trial, à la fin de «Crap Rap» - I believe in the R&R dream/ I believe in the primal scream - Et hop c’est parti. Pas plus difficile, tu flashes et tu agis. Il a ce qu’il appelle lui-même a year-zero mentality de young punk. Rien à voir avec le primal scream de John Lennon. Les punks nous dit Baby G ne commenceront à écouter les Beatles qu’au moment où Paul Weller va pomper «Taxman» pour faire «Start». Du coup, Beattie achète Revolver. Avec Beattie, ils écoutent aussi les deux premiers albums des Stooges sous acide, allongés par terre, la tête entre les deux enceintes - You haven’t lived until you’ve heard «We Will Fall» and «Dirt» in this way, I’m telling you. Beautiful primitive urban blues - Puis il cite Dickinson qui qualifiait les Stooges de «primitive modernists». Selon Baby G, les Stooges ont créé «a post-adolescent urban white bues qui encapsulait les peurs, les espoirs, les frustrations sexuelles et l’ennui existentiel of teenage outsiders everywhere.»

Alors qu’il vient de lancer Primal Scream avec le copain Beattie, Baby G commence aussi à fréquenter les frères Reid. Il va vivre avec les Mary Chain l’un des épisodes les plus excitants de l’histoire du rock anglais. Et grâce à lui, on va pouvoir le vivre de l’intérieur. Comment commence cette belle aventure ? Assez bêtement : Baby G reçoit chez lui une cassette C-90 que lui envoie Nick Lowe. Dans le petit mot d’accompagnement, il indique à Baby G que les deux guys qui sont leur la cassette pourraient éventuellement se joindre au duo Primal Scream qu’il forme avec le copain Beattie et que Lowe a vu jouer sur scène. Sur la cassette est écrit le nom du groupe au stylo bille : Jesus and Mary Chain, et quatre titres de chansons : «Never Understand», «Upside Down», «Inside Me» et «In A Hole». Baby G rencontre les frères Reid un jeudi du mois de juin. Jim et William nous dit Baby G portent des cheveux très haut sur le crâne et ceux de Douglas Hart, le bassman, sont noirs de jais et bouclés. Il manque le batteur Murray qui est à l’école. Alan McGee est l’un des premiers à s’intéresser au groupe, car sur scène, c’est le chaos garanti : ils sont tellement défoncés que William joue «In A Hole» alors que Jim chante «Upside Down» et Douglas joue «Inside Me», et c’est là qu’ils commencent à se battre comme des chiffonniers, devant tout le monde. Pif paf, dans ta gueule, et ils quittent la scène. C’est la fin du set qui n’a même pas commencé. Pour McGee, c’est du genius à l’état pur. Quand Baby G les voit jouer à Glasgow pour la première fois, William et Jim arrivent en titubant sur scène, ils se cognent partout - It was just noise, carnage - Ils jouent trois cuts - a cacophonous, violent fuck-up noise, it was completely unmusical, mais en même temps ça faisait sens pour Beattie et moi, parce qu’on comprenait ce langage - Baby G apprend que les frères Reid appréhendaient tellement de monter sur scène qu’ils avaient bu comme des trous, au point qu’ils tenaient à peine debout. Au point de se faire virer de la scène par les videurs. Les frères Reid nous dit Baby G s’abreuvaient directement «à la source de l’universal psychedelic punk energy.» Ils proposaient le «true primitive power of rock and roll en opposition à la musique clean, safe et asexuée dont les médias et les music papers gavaient les gens.» Et puis un jour, McGee appelle Baby G pour lui annoncer que les May Chain ont viré leur batteur Murray et qu’ils le veulent lui, Baby G, comme batteur. Le seul problème c’est que Baby G n’est pas batteur. Pas grave. Et hop tournée en Allemagne avec les Mary Chain, le Biff Bang Pow d’Alan McGee et les Mod punk rockers d’Aberdeen, les Jasmine Minks. Baby G profite de l’occasion pour préciser que les Mary Chain ne répétaient jamais - Every single gig was freefall. Every gig. Even when we made Psychocandy - Il garde aussi des souvenirs attendris de camaraderie, quand ils dormaient tous les quatre dans des sacs de couchages, serrés les uns contre les autres sur la plancher d’un appart, in the cold autumn London night. Jouer sur scène avec ces trois loustics, ça reste pour Baby G les meilleurs souvenirs de sa vie. Ils n’ont même pas besoin de se parler entre eux. Un regard suffit - The best relationships are like that - Il va loin, le petit Baby G car il parle même de spiritualité. Au retour de leur tournée allemande, ils découvrent que dans le NME, un journaliste déclare : «Les Mary Chain sont the new Sex Pistols.» Ça y est, ils commencent à décoller. Les labels se rapprochent de McGee qui est leur manager. Baby G est de plus en plus épaté par la grandeur des Mary Chain - The Chain as a band was perfect as it was: four punks with clear minds and a defiantly powerful, well thought-up group aesthetic (...) I loved the purity in the Mary Chain; it was kind of religious. Actually, it WAS religious. Pure rock and roll - Mais en 1985, chaque fois que les Mary Chain jouent à Londres, ça tourne à l’émeute. Baby G dit que dès qu’ils commencent à jouer, une pluie de missiles s’abat sur eux - Et soudain le public attrape Jim, des mecs du service d’ordre sont obligés d’aller le récupérer car des mecs le tabassent - C’est la guerre nucléaire ! - And the missiles were coming the whole time - Comme il l’a déjà précisé, les Mary Chain ne répètent jamais. Ils démarrent un cut et s’arrangent pour le finir - it was free-form madness - Ils font une version du «Mushroom» de Can que Baby G qualifie de «creepy crawl death-rattle low moan blues». Le concert à l’Electric Ballroom est encore plus extrême, nous dit Baby G. Des gens viennent pour zigouiller les Mary Chain. Pour étayer son propos, Baby G cite une anecdote : «Jim Reid était allé voir Nick Cave & the Bad Seeds à l’Hammersmith Palais et un mec est venu le trouver pour lui demander : ‘Are you the singer in the Mary Chain?’. Et six mecs tombent sur Jim pour lui filer la branlée du siècle. Gave him a doing. Kicked fuck out of him. Alors que Jim gît au sol dans une mare de sang, les mecs lui disent : ‘Dis à ton fucking batteur qu’il est le prochain !’.» Même si Baby G essaye de se faire passer pour un petit dur, il ravale sa salive. Il sait que ces mecs-là ne rigolent pas et qu’il va prendre une trempe.
En 1985, il part en tournée américaine avec les Mary Chain. New York, punk city of my dreams. Premier arrêt au Gem Spa sur St Mark’s Place pour rendre hommage aux New York Dolls, tels qu’on les voit au dos de la pochette de leur premier album. Puis Midnight Records, pour les albums psychédéliques. Cette fois, la tournée se passe bien, pas de violence. Sur scène, William Reid règne sans partage. Il sort un son qui est un «shot de high-grade amphetamine sulphate, pure white light, white heat, wired soul genius.» - His gonzoid riffage and energy sprawl would propel me forward rhythmically - Et puis, les premières crevasses apparaissant dans ce beau rêve de fraternité. Un jour, il va chercher sa copine Karen à la gare. Elle arrive de Glasgow et lui apprend qu’elle va jouer à sa place le soir-même dans les Mary Chain. Ça interloque Baby G pour deux raisons : un, Karen ne sait pas battre le beurre, et deux, ses frères spirituels ne lui ont rien dit. Baby G lui demande quand même pourquoi elle a accepté, sachant qu’elle lui retirait le pain de la bouche. Oh, Karen n’est pas à ça près. Elle dit avoir d’abord refusé, mais William a insisté, lui promettent de lui donner tout ce qu’elle désirait si elle acceptait de jouer avec eux. Alors elle a demandé un gramme de speed et William est parti en courant lui chercher ce qu’elle demandait. En fait, le problème, c’est que Baby G qui a les yeux plus gros que le ventre joue dans deux groupes à la fois, les Mary Chain et Primal Scream. Les groupes sont même souvent à la même affiche, et Baby G chante et gratte sa gratte dans l’un et il bat le beurre dans l’autre. On appelle ça de l’omnipotence et c’est une tare qui ne convient pas, mais alors pas du tout, à un mec aussi intègre que William Reid. Et ça ne servait à rien d’en parler. Aussi le soir même, quand ses copains de Primal Scream voient Karen jouer à sa place, ils demandent à Baby G pourquoi il ne joue pas. What could I say ? Les frère Reid ne parlent jamais des problèmes. Baby G doit fermer sa gueule et l’accepter, parce que les Mary Chain sont leur groupe. Il sent bien que c’est le commencement de la fin. Effectivement, le lendemain, Jim Reid appelle Baby G au téléphone, ce qu’il ne fait jamais. Il l’appelle pour lui mette le marché dans les pattes : soit il devient le batteur des Mary Chain à plein temps, soit il dégage - We don’t want you to be in Primal Scream anymore. You can’t be in both bands, you have to make a choice - Le choice est vite fait. «Ok I’ll be in the Scream, then. And that was that.» Fin de l’épisode. Baby G est bouleversé. Il note toutefois que pour enregistrer leur deuxième album, the existential blues album Darklands, ils ont utilisé une boîte à rythme pour le remplacer, which is cool. Puis il découvre qu’ils avaient déjà prévu un batteur en remplacement pour les concerts, le fameux John Foster Moore, qui fera ensuite équipe avec Luke la main froide dans Black Box Recorder.

L’autre personnage principal de cette apologie de l’éternelle adolescence, c’est la dope. Baby G en est incroyablement friand, plus encore que des bombecs. La dope se situe au même niveau que l’engagement politique et le rock, c’est un moteur, une psycho-vitamine dirait Marc Z. Baby G attaque sa carrière de drug-head avec les acides, pour vivre en osmose avec sa passion pour le rock psychédélique. Il découvre aussi le pouvoir du sexe sous acide avec sa copine d’alors, la fameuse Karen évoquée plus haut. Puis quand il fréquente McGee, il lui balance le fameux slogan de Ian McCulloch : «No snow, no show !», formule magique qu’il prononçait selon Baby G chaque soir avant de monter sur scène. Avec des yeux devenus globuleux, Baby G traîne dans les parties avec Throb et les mecs de Felt où tout le monde est sous speed and magic mushrooms. Il découvre ensuite l’ecstasy, «plus adapté au vibes de basse et aux sons électroniques, alors que le speed convient mieux aux amateurs de high-energy rock and roll.» Il ajoute que «the Southern Soul sounds is great on smack et que l’herbe est parfaite pour le Jamaican Reggae and dub.» - Different drugs for different sounds - Il en connaît un rayon, le petit Baby G. Pas la peine de lui faire un dessin. Il achète son premier E (ecstasy) aux Happy Mondays. Il en éprouve une grande fierté. Mais sa dope préférée reste le speed - Ecstasy was a different psychotropic trip. My life was changing and I didn’t even know it - Quand ils roulent vers le Nord pour aller jouer à Londres, ils prennent du speed et quand ils redescendent à Brighton après le concert, ils droppent des Es. Ils goûtent pleinement à la joie et à la liberté de leur jeunesse. C’est pour ça que la scène acid house lui plaît, tout le monde est sous E, il parle d’un «holy sacrament drug», alors que la scène indie pue la bière, et Baby G ne supporte pas les pintes. En plus ces mecs-là ne prennent même pas de drogues. Baby G n’aime pas non plus les pubs - Pubs were never my scene - Un jour Throb ramène des tablettes de dexys, la fameuse Dexedrine qu’il qualifie de best drug in the world - We all took dexys to do the interview - Un jour en arrivant au studio, Toby leur dit à tous les trois, Baby G, Throb et Innes d’ouvrir la bouche et il leur balance à chacun des pilules. Il en a un bocal plein. Ils veulent quand même savoir ce qu’ils avalent et Toby se marre : «C’est ce qu’a avalé Keith Moon la nuit où il est mort.» Alors les trois autres répondent : «Yeah ! Great !». Le problème, c’est qu’après, la situation devient bizarre : les quatre Primal Scream tombent dans les pommes. Quand Dick Green l’associé de McGee chez Creation appelle l’ingénieur du son Leggatt pour savoir comment se déroule la session, Leggat est bien embêté. Il répond : «The band are in a coma.» Green ne comprend pas : «What d’you mean, they’re in a coma ?». Alors Leggatt décrit ce qu’il voit : «Well, Bob and Innes are on the floor, Throb est sur le canapé et Toby vient de se glisser sous la console de mixage.» Les pills de Keith Moon sont des somnifères qu’on administre dit-on a des éléphants. Quand ils commencent à palper des gros billets, Throb achète des gros pochons de coke. Il en fait même le commerce à Brighton. Il a acheté une bagnole pour faire les trajets et bien sûr il n’a pas de permis. Baby G tente de le ramener à la raison, lui disant que s’il se fait choper, il va détruire le groupe. Mais Throb se marre. Il passe vite au freebasing - We all did. It was great fun.
Retour aux balbutiements de Primal Scream. Beattie et Baby G enregistrent des démos avec Elliot Davies qui dit à Baby G : «The songs are both very good. Bob you’re not a singer.» Choqué, Baby G lui demande ce qu’il veut dire et l’autre lui explique : «You’re not a proper singer like Al Green or Marty Pellow, you’re more like Bernard from New Order.» Baby G s’en tire à bon compte, car il adore New Order, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Heureusement, on finira par trouver quelques points de désaccord avec Baby G. Puis il rencontre son futur Soul Brother, Robert Young, alias Dungo, un gosse du quartier. Un jour Baby G le croise dans la rue et lui demande ce qu’il a eu comme cadeau de Noël. «A Telecaster guitar !». Baby G découvre que son nouveau copain est bourré de talent. Il écoute les Byrds et Love. Ils se mettent vite à la recherche d’un son - We were aiming for a mix of ecstatic sixties joyous transcendental psychedelic pop and modern eighties electronic dance beats - Comme tout le monde, Baby G goûte au plaisir suprême qui est de jouer dans un groupe et il sait dire pourquoi c’est une affaire sérieuse : «Rock and roll at its highest point is serious magic. An alchemical transformation is possible, but only if people with the right attitudes, minds and spirits are involved in the ritual.» Au début, ils sont cinq, Beattie gratte sa douze, Robert on bass, Baby G sur une six cordes électrique et au chant, Tam McGurk au beurre and our pal Joog on tambourine. Aux yeux globuleux de Baby G, Robert est le musicien le plus doué qu’il connaisse. Un jour, alors qu’il sont en tournée, ils s’arrêtent pour pisser un coup au bord de la route. C’est là qu’ils découvrent le pot aux roses : Robert est monté comme un âne - For fuck’s sake would you look at the size of that thing? - Robert ne comprend pas pourquoi ils s’extasient devant sa queue. Baby G lui dit qu’elle est «like a fucking python». Alors Robert se marre et leur dit que le problème n’est pas la grande taille de sa queue, mais plutôt la petite taille des vôtres, it’s just that you guys are all too wee - C’est là qu’il chope le surnom de Throb.
Primal Scream commence à se bâtir une petite réputation mais bizarrement, John Peel ne s’intéresse pas à eux. Il s’intéresse plus nous dit Baby G aux groupes with girls in it, «surtout si elles ne savent pas jouer de leur instrument.» Il est revanchard, le petit Baby G, faut pas lui marcher sur les doigts de pieds. Puis Andrew Innes rejoint Primal Scream.

Leur premier album s’appelle Sonic Flower Groove et paraît en 1987, en plein boom des futals de cuir noir. Dès le «Gentle Tuesday» d’ouverture de balda, on sent un léger problème : Baby G n’a pas de voix. Ce qui semble logique, vu son extrême jeunesse. Ces sont les deux guitaristes Throb et Innes qui mènent le bal. Mais le loup - c’est-à-dire la voix - n’y est pas. Ça reste de la pop d’agneaux blancs comme neige. Baby G chante comme une savonnette. Bizarre qu’il ne s’en rende pas compte. Il est assez pénible sur «Sonic Sister Love», et les cuts suivants ne valent guère mieux. On sent une volonté Velvet dans «Love You», mais dès que Baby G ouvre le bec, il ruine tout. Il se prend pour les Ronettes et ça devient très compliqué, pas pour lui, mais pour l’auditeur qui au vu de la pochette s’attendait à entendre du beau gaga de Glasgow. Baby G fait encore son cirque dans «Aftermath» et bat tous les records d’immaturité.
Beattie quitte le groupe après Sonic Flower Groove. Il emporte avec lui le son de sa douze. Il ne voulait pas quitter Glasgow, alors que Baby G, Throb et Innes voulaient se barrer. Pour Primal Scream, il faut tout reprendre à zéro. Ils décident d’aller plus sur un son twin guitar attack comme dans le MC5. Ça tombe bien, car Throb ne porte plus que du cuir noir, et il peut jouer aussi bien que Johnny Thunders et Wayne Kramer. Pour la voix, ça reste compliqué.
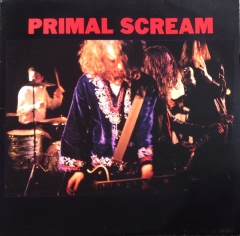
Leur deuxième album sans titre paru sur Creation vaut vraiment le détour. Plus rien à voir avec le soufflé raté du Sonic Flower Groove. Cette fois, ça vole assez haut. «Ivy Ivy Ivy» éclate au Sénégal avec des chœurs de Dolls. Ils remontent dans le heavy power d’Ivy Ivy Ivy comme des saumons, c’est un vrai smash et cette fois la voix de Baby G colle mieux à la réalité, Throb et Innes ramènent les meilleurs power chords d’Écosse. On voit arriver des clap-hands sur le tard et ça devient du pur Mary Chain. C’est Andrew Innes qu’on voit sur la pochette avec sa Les Paul. La fin d’Ivy sonne comme une fabuleuse descente aux enfers d’aw aw aw avec un Throb all over the sound. Puis Baby G se remet à chanter comme la reine des brêles dans «You’re Just Dead Skin To Me». Il aurait fallu l’empêcher ce chanter. Ils tentent ensuite de sauver l’album avec «She Power» et renvoient Baby G au front. Quelle erreur ! Si on ouvre le boîtier, on tombe sur une photo de Baby G, encore une erreur. Il faut aller à l’intérieur du dépliant pour trouver une photo de Throb torse nu avec sa Les Paul blanche. Baby G se prend encore pour un chanteur dans «I’m Losing More Than I’ll Ever Have». Pire encore : il se prend pour un Soul Brother. Throb sauve le cut avec un killer solo flash. Ils tapent ensuite «Gimme Some Teenage Head» sur les accords du MC5. Ils tapent dans la caisse. C’est la came de Throb. Il joue les accords de «Kick Out The Jams». Le pauvre Baby G est embarqué comme un fétu de paille. Ils font une cover du «99th Floor» des Moving Sidewalks. Puis il tapent «Lone Star Girl» au heavy glam. C’est le même son qu’Ivy Ivy. Les tornades noient la voix de Baby G, donc ça passe. Encore une énormité avec «Sweet Pretty Thing» amené au heavy drumbeat de Glasgow. Ça joue au c’mon now, Throb ramène le power, c’est lui l’âme du Scream.
Ils enregistrent cet album avec le batteur Toby Tomanov, un vétéran de toutes les guerres et ex-junkie. Pendant l’enregistrement d’«Ivy Ivy Ivy», Toby et Throb disparaissent un moment et quand ils reviennent dans le studio, il est évident nous dit Baby G que Toby had shot Throb up with some smack. Cette nuit-là Thob a joué comme un dieu, et il continuait à jouer quand le groupe s’arrêtait.
En 1988, McGee dit à Baby G que plus personne ne s’intéresse à la musique que joue Primal Scream - It’s so old-fashioned, personne ne veut plus écouter ça - Mais ils continuent de jouer et de se doper, Baby G est fier de son groupe et de ses «two great guitar players on Les Pauls blasting through hundred-watt Marshall stacks.» Ce soir-là, Andrew Innes monte sur scène tellement défoncé qu’il oublie de se brancher. Ce sont des kids au premier rang qui l’alertent : «You ain’t plugged in mate !».
Tenement Kid s’achève sur Screamadelica. Baby G envisage sûrement un deuxième volet, comme le fit avant lui Brett Anderson qui pour son premier volet autobiographique s’arrêtait aux portes du succès commercial de Suede. Baby Gillespie utilise la même ficelle de caleçon mais il en profite pour dresser une étrange apologie de l’acid-house qui, faut-il le rappeler, nous a tous bien barbés à l’époque. On appelait ça les machines, et Screamadelica est un album de machines.

Alors que les cuts des deux premier albums sont composés sur des guitares, ceux de Screamadelica le sont sur un piano. Throb adore Carole King et Brian Wilson. Pour Baby G, Screamadelica est un song-based record. Cause toujours. Il faut bien dire qu’il en pince surtout pour l’acid-house. Ils vivent à Brighton et vont traîner dans les acid house clubs. Throb rechigne un peu, il appelle ça du fucking disco shit. Dans les acid house parties, Baby G découvre une étrange forme de fraternité - No one is a stranger on ecstasy. It’s a chemical brother- and sisterhood - Il a l’impression de vivre encore une fois les plus grands moments de sa vie sur les danceflloors de l’acid house phenomena, some of the greatest, most transcendant, connected and soulful moments of my life - C’est pourquoi il compose «Don’t Fight It Feel It». Ah les dancefloors ! Que deviendrait-on sans les dancefloors ? Comme si on n’avait pas bien compris, Baby G en rajoute une petite couche : «To me, acid house culture was a joyful celebration of underground resistance, not with guns, bullets and bombs but with love, drugs, great music, sex and righteous youthful energy.» Et pour enfoncer son clou (rappelons que le destin du clou est d’être enfoncé), Baby G affirme ceci : «Nous n’aurions jamais connu le succès sans l’acid house. Screamadelica n’aurait jamais pu exister sans l’acid house. Primal Scream n’aurait jamais eu une carrière de trente ans sans l’acid house.»
Alors arnaque ou pas arnaque ? On est encore nombreux à se poser la question. Mais pour ceux qui ne supportent pas les machines, la réponse est claire. Mis à part le «Movin’ On Up» d’ouverture de balda, c’est de l’electro. «Movin’ On Up» est un joli cut de Stonesy, mais le loup, c’est-à-dire la voix, n’y est pas. Ils refont les chœurs de «You Can’t Always Get What You Want» avec un solo de Throb. On imagine le carton qu’aurait fait le Scream là-dessus avec un vrai chanteur. Ensuite, les machines arrivent et Baby G chante comme une casserole sur le «Slip Inside This House» du 13th Floor et tout ce qui suit. Une vraie malédiction. Quelle arnaque ! Les gens considèrent Screamadelica comme une album classique, mais c’est une catastrophe épouvantable. On se sent puni d’écouter ça. C’est l’album des caprices de jeunesse de small Baby G.
Il faut aussi saluer le style parfois ronflant de big Baby G. Quand il évoque l’English Disco club de Rodney Bingenheimer à Los Angeles, il parle «d’underground freaks like Kim Fowley, New York Dolls ans Iggy Pop carroused with superstars like Led Zeppelin and Quaalude-damaged teen queen glam-rock groupies like Lori Maddox ans Sable Starr.» Il voit aussi arriver «a bunch of Hollywood post-hippie cocaine cowboy cognoscenti» qui vient assister au tournage d’une vidéo de Neil Young. Ailleurs il met le turbo sur le langage musical : «Cool young people into sharp threads and the latest US soul imports. Swap speed for ecstasy and Sue, Tamla and Stax records for Trax, DJ International and Carnaby Street, King’s Road for Hyper Hyper, Ken Market, Browns, South Moulton Street and you get the picture.»
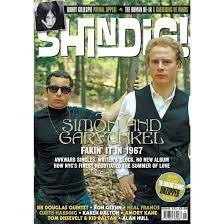
Pour saluer la parution de Tenement Kid, Jon Mojo Mills accorde six pages à Baby G dans Shindig!. Le principe de l’interview permet à Baby G de brosser des panoramas complémentaires, comme par exemple celui des groupes anglais des années 80 qui à ses yeux reflétaient la cupidité et la vulgarité du Thatchérisme. C’est pour ça qu’il a rejoint les Mary Chain qui incarnaient l’exact opposé de cette vulgarité - We wanted something more underground, more authentic, more deranged, more poetic and more righteously sincere - Et il ressort ses modèles Syd barrett, Sky Saxon et Arthur Lee. Puis dans un deuxième souffle Jim Morrison, Lou Reed et Iggy Pop - The Stooges were like a godhead band for us - Et puis les Cramps. Il revient aussi sur l’acid house : ça se passait dans les clubs avec les meilleures drogues de l’époque - Ecstasy was a great drug. It was just such an utterly exciting time. And it was vital in the way that rock music had ceased to be - Comme Mojo Mills l’entraîne sur le terrain de la relève, Baby G cite l’exemple de Sam France, le mec de Foxygen. Il dit n’avoir jamais vu quelqu’un d’aussi brillant et pouf, le groupe s’est dégonflé comme un ballon de baudruche. Et pour lui, la relève, ce sont surtout les rappers noirs américains, the rock stars of today. Et comme Mojo Mills le branche sur le style vestimentaire, Baby G cite ses références : Johnny Thunders; Peter Tosh, Gregory Isaacs, Bryan Ferry 1974-78, Gene Vincent, Elvis et John Lydon.

À l’époque, les gens reprochaient au Scream d’avoir collé un drapeau confédéré sur la pochette de Give Out But Don’t Give Up. En fait, l’album était enregistré chez Ardent à Memphis et pour entrer en osmose avec la légende de Memphis, le Scream avait opté pour une photo de Bill Eggleston. De la même façon que sur les albums précédents, Baby G ruine pas mal de cuts à commencer par «Jailbird». Il jongle avec les clichés du genre monkey on my back. C’mon, oui c’est ça, t’as raison. Ils tapent «Rocks» au beat rebondi mais la voix de Baby G ne passe pas la rampe. Dommage car le cut est bon - Get the rocks out honey - Le coup de génie des Scream est d’avoir enrôlé George Clinton. C’est la raison pour laquelle on tombe sur «Funky Jam». Baby G se met à hurler comme un poulet décapité, il a dû faire marrer les mecs d’Ardent. Son magique mais ça n’a plus rien à voir avec Memphis. Denise Johnson vient sauver «Free» et Baby G ruine un bel essai de Stonesy, «Call On Me». George Clinton et Denise Johnson déboulent dans le morceau titre et tout à coup ça devient génial. Elle éclate le heavy groove de give out. On se demande ce que ce heavy doom de funk fait ici, mais on se régale. Il faut aller sur un album de Primal Scream pour trouver du heavy funk dégénéré ? Eh oui.

Ils sont de retour en 1997 avec Vanishing Point. Mauvais départ avec un «Burning Wheel» tapé aux effets. Ça cache la misère. Ils font entrer un sitar, la batterie puis la voix de Baby G. Aucun attrait, aucune valeur artistique. C’est mal barré. Trop de machines encore dans «Kowalski». Comme il ne sait pas chanter, Baby G chuchote. Encore plus insupportable : «Out Of The Void», il chante en rampant. Pour «Stuka», ils ramènent tout le power du dub. C’est le bassmatic le plus pur qui soit, mais les machines ruinent tout. Retour à la terre ferme de la Stonesy avec «Medication». Here we go ! Baby G est plus çà l’aise, il fait son Jag à la petite semaine, mais dès qu’il élève la voix, il redevient ridicule. Mais c’est bien qu’il essaye. Ne perdons pas de vue qu’il est avant toute chose un fan de rock. Les solos de Throb sont eux aussi des preuves de bonne foi. Ils enchaînent avec une superbe cover de «Motorhead». Comme la voix de Baby G est noyée dans l’assaut, ça passe. Throb joue des tas de layers qui entrent en collision, ça explose dans tous les coins. Voilà le grand Scream.

Pas mal de belles choses sur cet XTRMNTR paru en l’an 2000, à commencer par «Accelerator», authentique coup de génie. Le pauvre Baby G lance des c’mon dans la tempête, le son est poussé à l’extrême, mais pas la voix d’orvet de Baby G. Ce sont les autres qui font le son. Il faut dire que cet «Accelrator» remonte le moral car il arrive aussitôt après cette daube immonde qu’est «Kill All Hippies». Ils font n’importe quoi et toujours ce pas de voix. On n’entend que ça, le pas de voix. Bizarrement, sa voix passe mieux sur «Swastika Eyes», car il chante à ras des pâquerettes. Bon d’accord, on entend des machines et des spoutniks, mais c’est plutôt dans l’esprit d’Hawkwind, ce qui est un bon esprit. Instro de fantastique allure, «Blood Money» est bien plus puissant sans la voix. Ils rendent plus loin un bel hommage à Sun Ra avec «MBV Arkestra» et une belle poussée de fièvre. Retour aux valeurs sûres avec un «Shoot Speed/Kill Light» claqué du beignet par Throb, un space invader à la mode Hawkwind. Aw comme c’est bien balancé !

Paru en 2002, Evil Heat pourrait bien être le meilleur album du Scream. Les coups de génie y grouillent comme la vermine sur la peau d’un bagnard. Et paf, après quatre cuts calamiteux (dont une tentative foireuse de Kraftwerktisation des choses à coup d’Autobahn), tu prends «Rise» entre les deux yeux. Riffé au riff, c’est du big Scream monté sur le beat des vainqueurs. Belle dégelée d’outerspace, Rise ! Rise ! Ils tapent ensuite «The Lord Is My Shotgun» au heavy groove infectueux. C’est tout de même incroyable que ces mecs aient réussi à taper un cut aussi insidieux. Le petit Baby G fond dans la matière du son comme une noix de beurre dans une grosse poêle noire. Puis il chante «City» à l’avenant du bon gaga de Glasgow. C’est excellent car visité par le Throbbing Throb, here he comes ! Throb envoie des dégelées de guitares folles, power maximaliste, quand ça claque à la Throb, ça claque à la Throb, il est bon de le savoir. Ils tapent à la suite une énorme cover de «Some Velvet Morning», montée sur un heavy bassmatic d’electro, Baby G chante comme une fiotte, mais ça passe. Belle cover, Baby G ! Puis ils nous assaisonnent avec un coup de «Skull X» et ce petit démon de Baby G chante dans le vent de l’action. Il chante comme un Dylan qui serait en colère et ça devient tout simplement génial. Il est en plein vent, il chante face à la tempête, il est petit et frêle, mais il se tient droit, le small Baby G de Glasgow, il y va de bon cœur, c’mon baby do it again ! Le voilà au cœur du white heat de Scream.
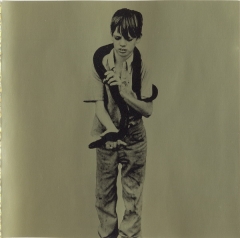
Le Riot City Blues qui paraît quatre ans plus tard est encore meilleur, ça explose dès «Country Girl», yeah ! ce démon de small Baby G fait le chanteur au cœur de la meilleure Stoney d’Angleterre, full blast de Scream, ça pousse dans l’ass des dieux du rock, ils ont trouvé le moyen de revitaliser la Stonesy et ça devient génial. On peut même dire qu’ils outrepassent la Stonesy, ils vont beaucoup plus haut, c’est très spectaculaire, tu ne t’en relèves pas, ils jouent avec une puissance rarement égalée, Country girl forever ! L’autre coup de génie de l’album s’appelle «The 99th Floor», explosé d’entrée de jeu, avec une montée en puissance inexorable, wild gaga shaking all over, c’est violent et beau à la fois. Small Baby G est dedans jusqu’au cou, il chante à la toute petite arrache, soutenu par les chœurs du diable. Ils restent dans la Stonesy pour «Nitty Gritty». la voix de small Baby G se noie dans l’excellence du sugar. Ça explose encore avec «When The Bomb Drops». Forcément, avec un titre pareil, ça ne peut qu’exploser. Small Baby G se tient bien au chant, il s’équilibre bien dans la fournaise, sa voix finit enfin par passer, comme si elle avait mué. Il sonne comme un petit imposteur, mais le rock grouille de petits imposteurs. Ça veut dire en clair que les vraies voix ne courent pas les rues. On les connaît et malheureusement pour lui, small Baby G n’en fait pas partie. Mais il a bien d’autres qualités, à commencer par la ténacité, car il faut du courage pour chanter sans voix dans un groupe comme Primal Scream. Ils se tapent plus loin une rasade de boogie avec «We’re Gonna Boogie», le boogie du Garbage Man, infiniment bon. Puis on reprend en pleine poire «Dolls (Sweet Rock’n’Roll)», small Baby G fait son shouter gaga à gogo et il fait illusion. Throb vole à son secours et gratte ses poux au génie pur. Le Scream jette tout son poids dans la balance et n’a jamais été aussi bon.

Paru en 2008, Beautiful Future est le premier des albums post-Throb. Apparemment, Innes veille au grain, car l’album tient sacrément bien la route. Baby G vise la postérité dès le morceau titre, on le sent très motivé, après quelques années de vaches maigres. Puis on est surpris par le souffle de «Can’t Go Back». Ils tapent dans l’extrême power absolutiste avec un killer solo flash in tow. Le groupe se compose d’Innes, Martin Duffy, Darren Mooney au beurre et Many on bass. C’est vite avalé et ça presse bien sur la purge. Les basses n’ont encore jamais sonné comme ça en Angleterre. Baby G chante presque bien. Ces mecs sont capables de rallumer la flamme. Ouf ils sont enfin débarrassés de l’acid house. Avec «The Glory Of Love», ils replongent dans le glam, le fucking Glam des origines, oh oh oh ça sonne comme du Bolan, ils lui rendent un sacré hommage. Chapeaux bas, les gars. Ils enchaînent avec un «Suicide Bomb» suicidaire, au bon sens du terme, ils ont une présence énorme, on peut leur confiance, après toutes ces années. Baby G est un vrai gamin, il y va de toutes ses forces. Cu’mon, c’est du pur jus de cu’mon ! Ils restent dans le heavy Scream avec «Zombie Man», authentique purée de heavy Stonesy, ils vont chercher la meilleure Stonesy d’Angleterre, avec des développements inespérés au nah nah de Zombie man. C’est un big album, bardé de son, comme le montre encore «Beautiful Summer», un nouveau modèle de heavyness. «I Love To Hurt (And To Be Hurt)» est amené au deep savoir-faire du Scream, c’est beau et plein d’esprit. Puis Baby G chante «Over & Over» comme une casserole, c’est plus fort que lui, il ne peut pas s’en empêcher. Back to the slam in the face avec «Necro Hex Blues». Ils adorent percuter de plein fouet. Baby G pose sa voix de Glasgow kid sur l’enclume pour recevoir les coups de marteau et les solos d’Innes sont fabuleusement incendiaires. Il garde le feu sacré du no way out, ça devient une occlusion attestinante d’effarence inclusive, un vrai shot de trash-boom uh-uh. Une façon comme une autre de dire qu’Innes fout le feu.

Sur la pochette de More Light, Baby G fait le lapin. Ça vaut le coup de rapatrier l’édition spéciale qui propose un deuxième CD, Extra Light. Étant donné que le groupe vieillit bien, il ne faut pas s’en priver, ce serait trop bête. Deux bombes sur More Light : «Turn Each Other Inside Out» et «It’s Alright». Le Turn Each Other est monté sur un big drive de basse infiltré par des guitares, avec une volonté d’hypno clairement affichée. Ça monte encore d’un cran avec «It’s Alright» et sa production à la Jimmy Miller, du shuffle à la surface du son et du piano en dessous, it’s alright, it’s okay, pur jus de Sticky Fingers, avec le développent du bassmatic, et il y va le Baby G, il est sur la crête, il mène bien le bal, and you cry ooh la la, il chante son couplet magique d’une voix d’ado et ça devient un vrai coup de génie. Par contre, il chante mal sur «River Of Pain», il concocte des effets de voix qui te mettent mal à l’aise. Il chante en chuchotant. Dommage. Il chuchote encore sur «Culturecide», c’est battu comme plâtre et le Scream joue le heavy doom. Pour ça, ils sont imbattables en Angleterre. Ils sont sans doute les derniers à pouvoir sortir un son aussi massif. On entend un solo de sax dans «Hit Void», et dans «Tenement Kid», Baby G se prend pour une star. Il exploite la misère de ses parents, il sonne comme un parvenu, c’est très bizarre, I don’t know why. Il est même assez ridicule sur ce coup-là. Puis avec «Invisible City», il nous fait le coup de - pardonnez l’expression - l’atroce merdier new-wave, c’est n’importe quoi, avec des crack-house zombies et des one night stands, tous les clichés à la mormoille - Profit freak/ Nazi radio/ Politicians/ Death TV - Et ça continue de péricliter avec une reprise de «Goodbye Johnny» qui est une insulte à Jeffrey Lee Pierce, puisqu’ils transforment cette merveille en fiotte de pop à la petite semaine. Ça donne la nausée, rien que de penser qu’un avorton puisse transformer l’art sacré de Jeffrey Lee Pierce en amusette acidulée. Gerbe assurée. Puis dans «Elimination Blues», il se prend pour un chanteur de blues, alors que derrière, semble-t-il, Robert Plant fait des ah-ooh et des eh-ooh. On aura tout vu. Dernier spasme d’ignominie avec un «Walking With The Beast» qui n’est heureusement pas celui du Gun Club, mais en tant que chanteur, Baby G s’y grille pour de bon. Il est d’une rare ingénuité, ce qui lui fait croire qu’il peut tout se permettre. Sur Extra Light, on trouve des remix et un «Nothing Is Real Nothing Is Unreal» chanté à ras des pâquerettes. Le cut est magnifique, comme incendié, une vraie cavalcade à travers le heavy rock britannique, c’est excellent car ça bombarde bien les tympans. Baby G chante toujours aussi mal, mais on se goinfre de son. Dans «Running Out Of Time», il chante comme un gamin qui débarque au bordel pour la première fois : il prend sa voix d’eunuque, c’est plus facile. «Worm Tamer» est mal chanté, dommage car le cut est puissant. L’immaturité règne sans partage sur Extra Light. Et puis le côté electro revient à la charge sur le remix de «2013». Des machines dans tous les coins et la dimension artistique disparaît complètement. Bizarre que ces mecs-là ne l’aient pas compris à l’époque où c’était à la mode. On ne cache pas la misère avec des machines, la misère n’en devient que plus prévalente et du coup elle devient une sorte d’emblème.
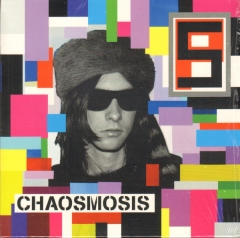
Le dernier album en date de Primal Scream s’appelle Chaosmosis et date de 2016. C’est le pompon. Baby G y chante de plus en plus mal. Et pour aggraver les choses, on ne voit plus que lui sur la pochette. Quand on l’entend chanter l’electro-beat atroce de «(Feeling Like A) Demon Again», on sent la moutarde monter au nez. Avec «I Can Change», il tente de se faire passer pour un chanteur de charme, mais c’est affligent. Il est nécessaire d’écouter cet album pour savoir jusqu’où Baby G peut aller trop loin. Il ne reste pas grand chose du Scream d’antan, cet album est celui d’une perdition artistique. Si on cherche un exemple de suicide commercial, il est là. Baby G se lance dans le balladif insidieux avec «Private Wars», mais ça fait mal aux oreilles tellement c’est mal chanté. Il aurait dû appeler cet album Déconfiture. Les machines sont de retour, sanctionnant la résurgence de l’horreur définitive («Where The Lights Get In») et avec «Carnival Of Fools», il passe à la diskö-pop de bubblegummer suprême. Quand il essaye de ramener du heavy sound avec «Golden Rope», on a du mal à le prendre au sérieux. Mais Innes est là, c’est seul cut rock de l’album, avec Darin Mooney au beurre et Jason Faulkner à la basse. C’est le dernier spasme du grand Scream. Dommage que Baby G le chante aussi mal. Il met sa voix au devant du mix et elle ne passe pas. Elle ne passera jamais. C’est une espèce de malédiction. Dès qu’il arrive au micro, tout s’écroule.

Pour les ceusses qui ne veulent pas s’encombrer avec des piles de CDs, il existe une compile du Scream très bien faite - Dirty Hits - sur laquelle se sont jetés tous les fans du groupe à l’époque, car on y trouve une version de «Some Velvet Morning» chanté en duo avec Kate Moss et qui fit sensation. On y trouve aussi tous les grands shoots de Stonesy («Movin’ On Up» et «Rocks»), des choses comme «Jailbird» passent beaucoup mieux dans ce contexte de double concentré de tomate. Bien sûr, les coups de génie figurent en bonne place : «Accelerator» et «Shoot Speed/Kill Light». Bizarrement les cuts de Riot City Blues brillent par leur absence.

Dans Uncut, Michael Bonner centre son interview sur l’album que Baby G vient d’enregistrer en duo avec Jehnny Beth, Utopina Ashes, modelé sur les fameux duos country cités en exemple : George Jones & Tammy Wynette, Gram Parsons & Emmylou Harris, Waylon Jennings & Jessi Colter, Kate & Anna McGarrigle. Baby G cite aussi les Everly Brothers. Il indique ensuite de manière insidieuse qu’il existe aujourd’hui deux Scream, celui qui continue de tourner, et un Scream plus sédentarisé qui bosse en studio. C’est-à-dire Innes et lui. C’est Innes qui a déterré les fameux Original Memphis Recordings, enregistrés par Tom Dowd chez Ardent à Memphis, et qui ont été remixés par Jimmy Miller, un Miller qui selon Baby G a dénaturé le son. Puis Innes et lui ont compilé les singles pour en faire Maximum Rock’n’roll et maintenant voilà Utopian Ashes, un nouvel experiment. Baby G dit aussi adorer les rock books, il cite ses préférés : Rythm Oil et The True Adventures Of The Rolling Stones de Stanley Booth, le Papa John de John Phillips, le Chronicles de Dylan of course et son livre de chevet, Hellfire de Nick Toshes, car enfin existe-t-il une vie plus rock’n’roll que celle de Jerry Lee ? Bien sûr que non. Et bien sûr que oui, l’idée d’un tome 2 de Tenement est dans l’air.
Signé : Cazengler, Primate scream
Primal Scream. Sonic Flower Groove. Elevation Records 1987
Primal Scream. Primal Scream. Creation Records 1989
Primal Scream. Screamadelica. Creation Records 1991
Primal Scream. Give Out But Don’t Give Up. Creation Records 1994
Primal Scream. Vanishing Point. Creation Records 1997
Primal Scream. XTRMNTR. Creation Records 2000
Primal Scream. Evil Heat. Sony 2002
Primal Scream. Riot City Blues. Sony 2006
Primal Scream. Beautiful Future. B-Unique Records 2008
Primal Scream. More Light. First International 2013
Primal Scream. Chaosmosis. First International 2016
Primal Scream. Dirty Hits. Columbia 2003
Bobby Gillespie. Tenement Kid. Orion Books Ltd 2021
Jon Mojo Mills : A child of Glam. Shindig! # 121 - November 2021
Michael Bonner : Where this rage comes from. Uncut # 290 - July 2021
Pas de filles au Harum

On a longtemps considéré à tort Procol Harum comme un groupe prog. C’est une erreur souvent due à l’ignorance. Quand on a écouté les albums de Procol, on sait qu’ils n’ont à rougir que d’une seule suite prog, l’insupportable «In Held Twas In I» qui flingue la B de Shine On Brightly et celle du fameux Live paru en 1972 et dont on attendait tant à l’époque. Une fois qu’on leur a pardonné cette incartade, on peut se plonger dans leur monde qui est celui d’une pop extrêmement mélodique, plutôt unique en Angleterre, qu’on dirait ancrée dans le XIXe siècle et les fastes de la cour viennoise.

L’album Grand Hotel en est la parfaite illustration, car nos amis du Harum s’y pavanent en fracs et en chapeaux claques, tout droit sortis d’un roman d’Hugo Von Hofmannsthal. D’ailleurs, ça tombe bien, car l’album tient bien son rang, aussitôt la perfection symphonique du morceau titre. Un certain Mick Grabham a remplacé Trower of London qui était le guitariste co-fondateur du groupe. Le thème de ce «Grand Hotel» est superbe, très viennois dans l’esprit. Il évoque la démesure de la valse des Habsbourg, telle que la filma jadis l’impérissable Luchino Visconti. Bien sûr, une certaine forme d’intimité avec les écrivains français et autrichiens de l’Avant-siècle facilite énormément la fréquentation du Harum. Il règne dans ses albums comme dans ces livres la même perfection stylistique, un goût comparable pour la mélancolie et la mort, la Mort à Venise, bien sûr. Revenons au Grand Hotel avec «For Liquorice John» - He fell from grace and hit the ground - un cut d’une beauté profonde qui nous entraîne soit vers le néant, soit vers la lumière, tout dépend comment on est luné. Et puis le coup de grâce arrive avec «Fires (Which Burnt Brightly)» - Let down the curtain/ And exit the play - sur lequel chante Christiane Legrand des Swingle Singers et des Double Six, la sœur de Michel Legrand, oh la lah, comme dit Gary Brooker au dos de la pochette. Christiane Legrand fait entrer au Harum sa magie vocale ! Robert Wyatt fait en gros la même choses dans «Old Europe» - Juliette and Miles/ Black and white city.
Si on ressort les albums du Harum de l’étagère, c’est pour dire adieu à Gary Brooker qui vient de casser sa pipe en bois. Cet excellent compagnon de route nous tint la jambe pendant sept belles années, de 1967 à 1974. On s’est arrêté en 1974 avec Exotic Birds & Fruit, mais eux ont continué. Comme Robert Wyatt, Gary Brooker a su nous rappeler que l’Angleterre était aussi le pays des grands mélodistes et grâce à quelques albums, il s’est taillé une place de choix dans l’étagère. Curieusement, les albums du Harum n’ont jamais fait l’objet de purges staliniennes, même au temps du punk. On savait qu’en les réécoutant, on ferait de nouvelles découvertes. Il faut dire qu’à l’instar de ceux de Dylan, les albums du Harum sont extrêmement bien écrits. La force du Harum fut d’avoir dans ses rangs un écrivain, l’ineffable Keith Reid.
Une autre façon de voir les choses : l’œuvre toute entière du Harum tient entre deux serre-livres : «A Whiter Shade Of Pale» et «As Strong As Samson», c’est-à-dire entre We skipped the light fandango et l’Ain’t no use in preachers preaching, ce qui veut dire en clair entre le premier album paru en 1967 et l’Exotic Birds & Fruit avec lequel nous décidâmes unilatéralement de refermer la lourde porte du Harum. Ou si le choix de «Whiter Shade Of Pale» paraît trop évident, on peut choisir d’un côté «Repent Walpurgis» et de l’autre «The Idol», deux somptueuses merveilles issues des mêmes albums. Pour aggraver le cas de la métaphore, on pourrait aussi prétendre que tout le rock anglais tient entre «Strawberry Fields Forever» et «Arnold Layne».

Aveuglés par l’éclat du Whiter Shade Of Pale, on ne rendait pas compte à l’époque à quel point ce premier album sans titre du Harum était génial. Une fois passée l’émotion causée par la pop d’orgue tentaculaire du morceau titre, on entrait dans le domaine frénétique de Trower of London avec «Conquistador» - Though I hoped for/ Something to find - Trower of London soliloque dans l’or de la matière et jette une poudre d’électricité dans le brillant shuffle du Harum. Mais c’est avec «Cerdes (Outside The Gates Of)» que Trower of London va conquérir l’Asie Mineure, avec cet amas de ramasse inspiré de «Season Of The Witch». Soudain, au revers d’un couplet, le Harum bifurque dans le Procol électrique, avec le chant étrange et pénétrant d’un Gary Brooker paré pour la postérité. Ah il faut entendre Trower of London mettre la pression au cœur d’un shuffle princier. Le Harum n’en finit plus de culminer. Des choses comme «Kaleidoscope» et «Salad Days» ont moins d’impact, mais Gary Brooker les chante à l’accent conquérant et il mène d’une main de maître cette pop ambitieuse et fabuleusement orchestrée. Trower of London revient envahir l’espace mélodique de «Repent Walpurgis» et le Harum atteint là le sommet de l’insularité, la pop anglaise éclaire le monde, Walpurgis sonne comme un ersatz d’excelsior parégorique, un laudanum de petroleum, un solace de Liberace.

On ne se lasse toujours pas des attaques de couplets de l’«As Strong As Samson» qui fait d’Exotic Birds And Fruit l’un des albums phares de l’an de grâce 1974. Cette façon qu’a Gary Brooker de redescendre dans le preachers preaching est assez héroïque, mais il sait aussi se montrer entêtant avec ses orgues et ses pianos dans «The Idol». C’est un peu comme s’il commandait aux éléments. Et comme chaque fois, il opère une descente en forme d’épitaphe - And so they found/ He’d nothing left to say - Une autre idole d’argile. Toujours le même protocole, avec «Beyond The Pale», l’Harum s’enracine dans la culture symphonique de la Mitteleuropa, on est dans cet univers culturel qui brasse la littérature, l’art moderne et la psychanalyse. Plutôt que de choisir, pour orner la pochette, cette nature morte de Jakob Bogdani, Gary Brooker aurait pu opter pour un portrait à la feuille d’or de Gustav Klimt. Encore une évidence qui cache la forêt. Ah comme le destin des évidences peut être cruel !

Comme déjà dit, Shine On Brightly (1968) et Live - In Concert With The Edmonton Symphony Orchestra (1972) sont des moitiés d’albums, avec leurs B ruinées par la prog. On sent avec «Rambling On», qu’ils passent leur temps à tenter de renouer avec les fastes de «Whiter Shade Of Pale». Pendant ce temps, Trower of London ramène du blues avec «Wishing Well», qui du coup sonne un peu comme une concession de la part de ce grand symphoniste habsbourgeois qu’est Gary Brooker. Il veille cependant au grain de l’ivraie avec «Quite Rightly So». L’Harum sera symphonique ou ne sera pas.

Par contre, sur le live, la version orchestrée de «Conquistador» emporte la bouche aussi sûrement que le ferait un boulet d’abordage. Dave Ball a remplacé Trower of London parti lancer sa fiévreuse carrière solo. Mad Ball d’abordage joue une sorte de wild electric guitar, il semble encore plus démesuré que le compère Trower. Ils font ensuite monter le «Whaling Stories» symphonique à des hauteurs épiques, histoire de passer en force. Rien de tel qu’un orchestre symphonique pour passer en force. Mad Ball d’abordage joue comme un diable sur cette moitié d’album live. Ils sacralisent ensuite deux merveilles tirées du troisième album du Harum, l’excellent Salty Dog, à commencer par le morceau titre, amené aux accords de piano emblématiques, et le chant gorgé de mélancolie du grand Gray Brooker s’en va dériver au large. S’ensuit l’extrêmement bon «All This And More» éperdu de shining through - The bright light of your star confronts me/ Shining through - C’est là où la beauté de l’art peut te réconcilier (provisoirement) avec la vie.
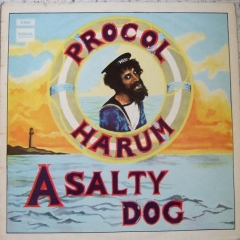
Oui, Bary Brooker est bien le maître des océans avec A Salty Dog. Il y a quelque chose de purement hugolien en lui, de la même façon qu’il y a quelque chose de purement verlainien en Keith Reid. Puissance homérique d’un côté, grâce sibylline de l’autre. La version studio d’«All This And More» paraît plus massive que la version symphonique, les poussées de fièvre y sont plus marquées, ainsi que l’aristocratie des membres du Harum. Ils retrouvent leurs aises grâce au gras double de Trower of London et s’offrent l’un des grands finals du siècle passé. On sent que Trower of London bout sous la surface de «The Devil Came From Kansas». Il prend l’allure d’un volcan éteint sur le point de se réveiller. Ce n’est pas non plus un hasard s’il ramène du heavy blues rock dans le «Juicy John Pink» qui ouvre le bal de la B, mais on perd tout le protocole du Procol.

Il reste encore deux albums coincés au milieu, Home paru en 1970 et Broken Barricades paru l’année suivante. Ce ne sont pas les meilleurs albums du Harum. Avec des choses comme «Whisky Train» (sur Home) et «Simple Sisters (sur Broken Barricades), ils se fondent dans la masse, ce sont des compos de Trower of London, plus musclées, pas loin de ce que faisait à l’époque un groupe comme Status Quo. Il faut attendre «Your Own Choice» pour retrouver la fibre poétique de Keith Reid - The human fate is a terrible place/ Chosse your own exemples - et «About To Die» nous ramène aux portes de la Mort à Venise. «Nothing That I Didn’t Know» tombe à point nommé pour nous rappeler que le son du Harum est unique en Angleterre. Et «Whaling Stories» nous emmène au large, au temps des baleiniers, chargé du soliloque exponentiel de Trower of London. Il peut atteindre des sommets.

Broken Barricades ne propose qu’une seule merveille intemporelle, «Song For A Dreamer», composée par Trower of London et qui par sa dimension aérienne évoque l’«Albatross» de Peter Green. Ils font encore un peu de boogie avec «Memorial Drive» et la mélancolie fait son retour avec «Luskus Delph». Mais on est surtout là pour les belles clameurs seigneuriales de Gray Brooker, telles qu’elles se répandent dans «Power Failure» et «Playmate Of The Mouth», deux œuvres magistrales arrosées de grandes lampées de son qui, pareilles à ces lames de Bermudes, s’en viennent mourir contre la coque. Broken Barricades est l’album heavy du Harum, mais chez eux, le heavy se fait avec élégance. C’est à Trower of London qu’échoit le privilège de clore l’album avec «Poor Mohammed», il le fait à la cloche de bois et s’en va chercher des noises à la noisette. Voilà donc un heavy boogie rock chanté à la mauvaise intention, avec un Trower of London qui gratte sa sale slide des faubourgs. Il entraîne le Harum sur la mauvaise pente du banditisme sonique, et personne ne peut rien pour empêcher ça.
Signé : Cazengler, Procucul la praline
Gary Brooker. Disparu le 19 février 2022
Procol Harum. Procol Harum. Regal Zonophone 1967
Procol Harum. Shine On Brightly. Regal Zonophone 1968
Procol Harum. A Salty Dog. Regal Zonophone 1969
Procol Harum. Home. Regal Zonophone 1970
Procol Harum. Broken Barricades. Chrysalis 1971
Procol Harum. Live. Chrysalis 1972
Procol Harum. Grand Hotel. Chrysalis 1973
Procol Harum. Exotic Birds And Fruit. Chrysalis 1974
L’avenir du rock
- On ne tient pas les Endless Boogie en laisse
(Part Four)
L’avenir du rock apprécie par dessus tout les soirées qu’il passe chez Hag et ses amis historiens dans un appartement de la rue de Buci. Après un bon repas, ils se rendent au salon et se calent confortablement dans les deux vieux chesterfield installés en vis-à-vis. Hag sert à chacun un armagnac divinement parfumé et les compères se jettent dans l’exercice préféré de tous les érudits : la conversation à bâtons rompus.
— Pourquoi sommes-nous tous si critiques vis-à-vis de notre époque ?
— L’explication est pourtant simple, lance l’avenir du rock : nous avons connu ces périodes magiques que furent les sixties et les seventies.
— Dis donc, avenir du rock, tu tombes dans le simplisme, maintenant ?
— Oh il fallait bien que l’un d’entre-nous se dévoue.
— Aurais-tu aimé vivre au Moyen-Âge, avenir du rock ?
— Ah quel rêve ! Autant vous l’avouer, les amis, j’aurais rêvé de me mettre au service de la Sainte Inquisition, pas pour brûler des sorcières, rassurez-vous, mais pour livrer aux flammes du bûcher ces horribles fantoches hérétiques que sont Stong et Slosh !
— Dis donc, avenir du rock, tu as la dent dure !
— N’inverse pas les rôles : ce sont ces atroces frimeurs qui nous empoisonnent l’existence depuis plus de trente ans. Même chose avec le chanteur Bonus. Et toi Hag, à quelle époque aurais-tu aimé vivre ?
— À Vienne au XVIIIe siècle, j’aurais pu voir Mozart en concert ! J’en aurais profité pour prendre une diligence en direction du Vaucluse et aller rencontrer mon idole le Marquis de Sade dans son château de Lacoste. J’en pince aussi sérieusement pour les années folles à Paris. Ahhhh traîner la nuit avec Duchamp et Man Ray ! Comme tous ces gens ont dû bien s’amuser ! Est-ce qu’une autre époque aurait les faveurs de ton cœur, avenir du rock ?
— La temps de cavernes ! Pas de factures, pas d’impôts, pas de problèmes avec les gonzesses, tu les traînes par les cheveux dans ta caverne et tu les enfiles vite fait ! Pas besoin d’écrire des poèmes à l’eau de rose ou d’aller sur des sites de rencontres. Tu as un petit creux ? Tu sors avec ton gourdin et tu assommes un ours. Pas besoin de carte bleue, pas besoin de caddy. Boom, tu te tailles un steak et tu en profites pour te tailler un manteau de fourrure !
— Oh toi, tu as trop lu Rosny aîné !
— De toute évidence ! Et puis j’aurais eu comme voisin Paul Major !

Comme ses amis ne savent pas qui est Paul Major, l’avenir du rock sort de la poche de son veston un CD qu’il emmène partout avec lui.
— Tiens Hag, si tu veux bien, mets ça dans ton lecteur de CD. Paul Major est le chanteur d’Endless Boogie, un groupe new-yorkais frappé par ce qu’il faut bien appeler la grâce préhistorique. Ça devrait vous plaire, les amis.
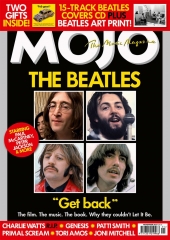
Frappé lui aussi par la grâce préhistorique de Paul Major, David Fricke s’enthousiasme. Il en fait quatre pages dans Mojo et les chapôte à coups de paleolithic riffing. Il remonte à la source de l’Endless Boogie, c’est-à-dire Jesper Eklow et Johan Kugelberg, deux Suédois qui bossent chez Matador à New York et qui chaque semaine se retrouvent dans un local de répète avec d’autres gens pour jammer l’Endless Boogie. Bon, l’histoire on l’a déjà racontée au moins deux fois ici, mais c’est bien de la raconter une troisième fois. Car l’avenir du rock se nourrit très précisément de ces histoires. Eklow pensait à l’époque que le monde avait besoin d’un combo that sounded like Neu! meets AC/DC. Alors ils empruntent l’Endless Boogie à John Lee Hooker et recrutent l’ideal frontman, Paul Major. Pas facile, car il faut le faire sortir de son appartement. Paul Major est un dealer légendaire in high-end psychédelia and small-pressing outsider rock, avec une connaissance encyclopédique de la musique et an epic cascade of dark hair. Paul Major donne son accord pour jammer chaque mardi. Fricke soigne ses références et parle de Blue Cheer-weight distorsion et de progressive blues-assault of the Groundhogs, de Can German’s heartbeat mélangé au rollin’ and tumblin’ de Canned Heat, avec comme cerise sur le gâtö, the cornered animal growl suggesting Captain Beefheart with Lou Reed monotone. Paul Major adore le son du groupe : «We’d get locked into that zone, one big thing swinging all around.» C’est exactement ce qu’on observe en concert. Ça clique et ça part. Paul Major décrit Endless Boogie «as Jesper’s aesthetic». Ils ont vingt-cinq ans d’écart (Major 67 et Jesper 52). Sweeney dit qu’Endless Boogie «is Jesper’s vision of what Paul should be doing». Il ajoute que selon Jesper, «Paul is the purest person. And we want to get this purity out of him.»
C’est Stephen Malkmus qui les fait connaître au monde en 2001 en leur demandant de jouer en première partie de Pavement au Bowery Ballroom. C’est à partir de là qu’ils se mettent à tourner et à enregistrer. Et ça fait vingt ans que ça dure. Ils n’ont ni manager, ni booker, ni roadies.

Their mystical simplicity is all over Admonitions, nous dit Fricke. Admonitions est encore un double album, ils ont besoin d’espace et de temps pour donner libre cours à l’endless boogie, leur concept tient sacrément bien la route, amené au raw de prehistoric Paul et au guitar licking libre de ses mouvements, ça dégorge à grosses lampées, comme un dégueulis de mal de mer et «The Offender» part pour 22 minutes, bienvenue sur les terres du Comte Zaroff, wild is wild viva Donovan ! Ça file droit dans l’hypno avec un Paul Major qui croasse comme un gator, ils visent à leur façon le no way tout, c’est un drug habit magnifique de résurgences, bien drivé à la tremblote de boogie down. Ils s’imposent comme les maîtres du jeu, on voyage avec eux, 22 minutes, ce n’est pas rien, si on part du principe que le temps c’est de l’argent. On n’accepterait ça de personne d’autre, même pas d’Hawkwind. Paul Major et ses amis s’égarent et se fondent dans l’avenir du rock. Il fait ensuite son Beefheart avec «Disposable Thumbs». S’ensuit un «Bad Call» supersonique. On voit bien qu’ils ne vivent que pour ça, pour le pré carré de la psychedelia. En même temps il faut savoir s’armer de patience, car on repart pour 9 minutes de dérive avec «Counterfeiter» qui vire vite Can. Avec «Jim Tully», ils jouent la carte de la lente montée en vrille, ils jouent le coup à la note insistante, pas de problème, c’est leur fonds de commerce. Ils ne savent rien faire d’autre que de monter en vrille et Paul Major entre dans le lard du son avec la voix de Merlin l’enchanteur, une voix grave et chamanique, what have you done, il exhale les mots comme des vapeurs lumineuses, un prodigieux climat s’installe et il pose ses mots dans la fraîcheur d’un matin d’hiver au fond des bois, but it’s better now, et là tu auras tout ce que tu peux attendre de la vie, l’ambiance, l’emprise sur le temps, l’épaisseur humaine, aw better now, ces fantastiques jammers se répandent dans les 22 minutes d’élongation du domaine de la hutte et ça scratche sur les cordes de la Les Paul, les notes se croisent et s’écrasent en une purée d’élévation lymphatique, on comprend alors exactement ce que font les Boogie-men, ils taillent leur route dans le son, ça joue dans les règles du lard fumant à la note éviscérée, ils pleurent toutes les larmes de leurs corps et le beat se dresse dans les fumées thuriféraires, on se croirait au fond d’un temple perdu dans la jungle. Tu les suis si tu veux, mais tu n’es pas obligé, vas-y, vas-y pas, c’est ton choix, nous on continue car le monde de Paul Major nous plaît infiniment, même s’il s’engage parfois dans les ornières du déjà vu. On se souviendra de «Jim Tully» comme d’une jam sans fin, de celles qui t’accompagnent jusqu’à l’aube. Paul Major joue son vieux va-tout dans la fournaise du jamming. C’est tout de même incroyable que ce jamming si intime puisse s’ouvrir au monde et intéresser les gens. Endless Boogie sur scène, oui, quand tu es défoncé, mais sur disque, c’est un peu spécial. Avec «The Conversation» tu t’embarques encore pour un certain temps, mais nous n’irons pas nous plaindre, même si se plaindre est devenu le sport national. Ils terminent avec «Incompetent Villains Of 1968», un dark doom un peu étrange monté sur un petit thème qu’altère la disto. Il semble que Paul Major ait décidé de faire claquer son goût pour le coït sonique. Admonitions est un album d’outsiders définitifs.
Signé : Cazengler, Endless boudin
Endless Boogie. Admonitions. No Quarter 2021
David Fricke : Endless Boogie. Mojo # 336 - November 2021
Inside the goldmine - Love is in the air
Baby Love aimait les hommes. Elle avait cette chance que beaucoup de femmes n’ont pas. Pour elle, une relation devait se vivre au sens large, comme s’il se fût agi d’universalisme. Embrasser son mec, c’était une façon d’embrasser l’univers. L’acte de donner du plaisir revêtait chez elle une dimension christique. L’amour charnel relevait du sacré, même dans son animalité. Il suffisait de ne pas la quitter du regard au moment des ébats pour mesurer cette grandeur d’âme. Elle se riait des tabous et ne ratait pas la moindre occasion de donner libre cours à sa fantaisie, qu’on soit sous l’emprise d’alcool ou de drogues. Sa quête d’une relation parfaite passait bien sûr par la prise de risques. Le jeu consistait parfois à rouler la nuit en ville, nus jusqu’à la ceinture, et nous livrer à toutes sortes d’acrobaties tout en remontant les avenues. Chaque sortie au restaurant était en fait prétexte à aller baiser comme des animaux dans les gogues. Baby Love se voulait initiatrice d’un culte de son invention. Elle développait sans même le savoir cet érotisme littéraire qui fit la grandeur d’érotomanes du calibre de Georges Bataille. On évoluait dans cette région de la pensée où l’intelligence se nourrit de la libido et réciproquement. Curieusement, il n’y avait pas la moindre trace d’intellectualisme en elle, au contraire. Bataille, Sade ou Molinier ? Ça ne l’intéressait pas. Ça ne pouvait pas l’intéresser. Elle ne s’intéressait qu’au vivant, qu’à l’instant présent, qu’à cette braguette qu’elle ouvrait doucement. Nous nous installâmes dans un bel appartement, au-dessus d’une pharmacie. Nos voix résonnaient dans les vastes pièces vides. Les trois stères de bois de chauffage déversées dans l’allée restèrent en tas dans l’allée. Nous savions que nous ne les utiliserions pas. La spirale universaliste nous entraînait toujours plus loin. L’empire des sens nous détachait lentement mais sûrement de la réalité. Revenir en arrière n’était plus possible. Au jour de l’an cette année-là, elle indiqua que le cadeau se trouvait dans le coffre de la voiture, au garage. Nous descendîmes avec nos verres de champagne et elle ouvrit le coffre : s’y trouvait une grande longueur de tuyau plastique enroulée et un rouleau de ruban adhésif. Nous branchâmes de tuyau sur le pot d’échappement et nous installâmes confortablement à l’intérieur de la voiture pour y mourir ensemble, selon son vœu d’éternité.

Le destin de Mary Love n’est pas beaucoup plus enviable. Ady Croasdell nous raconte son histoire dans le booklet d’une compile Kent, Lay This Burden Down - The Very Best Of Mary Love, parue en 2014 : cette petite black eut le malheur de naître dans un environnement d’une violence extrême, la mère de 16 ans qui se barre et le beau-père qui bat la gamine. Comme toujours dans ces histoires de familles black qui tournent en eau de boudin, c’est la grand-mère qui fait la sauveuse. Mary Love vit quelques années de répit avec sa grand-mère avant de replonger plus tard en enfer, lorsqu’adolescente elle retourne chez sa mère. Mais cette fois elle est en âge de se faire sauter par le beau-père qui, comme beaucoup de beaux-pères, a une bite à la place du cerveau. Elle finit par atterrir dans le Junvenile System of the State of California, à Sacremento. Qu’elle soit encore en vie à l’adolescence relève du miracle.
Elle a 17 ans quand elle participe à un concours de chant dans un club de Sacremento. J.W. Alexander qui est le manager de Sam Cooke la repère et c’est ainsi qu’elle démarre une carrière qui va faire d’elle une starlette de la Northern Soul. D’où Ady Croasdell et d’où la compile Kent. Mary Love va bien sûr se marier, trois fois, et avoir des enfants. Elle fricote un temps avec le cultissime Rudy Ray Moore, elle décroche même un petit rôle dans Dolemite, où elle chante deux cuts («When We Start Making Love» et «Power Of Your Love», présents sur la compile), et dans les années 80, elle a comme tout le monde sa petite période alcool, coke et crack, jusqu’au moment où elle rencontre Brad Comer, l’amour de sa vie. Brad et elle décident de se consacrer à God. Ils montent une petite congrégation à Moreno Valley, cent bornes à l’Est de Los Angeles et la congrégation grossit très vite, hundreds, then thousands nous dit Ady. Mary Love devient Mary Love Comer, elle enregistre à nouveau sur Co-Love Records et tourne éventuellement la tête des fans de Northern Soul en Angleterre, à commencer par Ady Croasdell qui réussira à faire venir le couple en 1993 pour un Northern Soul weekender at Cleethorpes. Mais comme Mary Love n’est pas faite pour les contes de fées, Brad Comer trouve another love et Mary Love se retrouve une fois de plus le bec dans l’eau.

Le première chose qu’on fait quand on écoute Lay This Burden Down - The Very Best Of Mary Love, c’est aller chercher les deux cuts de Dolemite, «When We Start Making Love» et «Power Of Your Love». Le deuxième n’éveille rien de particulier mais le premier réveille les bas instincts. On se sent bien auprès de Mary Love, elle groove à la volée et un guitariste l’accompagne. Elle chante par-dessus les toits du Start making love, elle simule le commencement de la pénétration, elle colle bien aux aspérités, just me and you, et jette toute sa passion dans l’expressionnisme. Au fil des cuts, on constate qu’elle est bonne dans tous les coups, elle se fond dans le moindre repli de la Soul d’expression corporelle. On voit pas mal de photos d’elle dans le booklet, elle cherche à plaire, toujours très coiffée, avec un petit air sexy. À l’époque de Co-Love, elle fait du diskö-funk, elle se faufile comme elle peut dans «Come Out Of The Sandbox» et le «The Price» qui referme la marche enterre une grande chanteuse qui s’appelait Mary Love. Ses coups de Jarnac datent de l’époque Modern. Elle y rivalisait directement de Sugar Love avec les Supremes, comme le montre «You Turned My Bitter Into Sweet». Elle chante au sucre avec tout le revienzy de Motown. Même chose avec «Hey Stoney Face», elle y dépasse même les Supremes, elle prend ça au stoney face, c’est puissant, chanté à la Love. Et ça continue sur la même lancée avec «I’ve Gotta Get You Back» qu’elle développe au sugar des Supremes. Mary Love forever ! Elle fait aussi du Modern Sound avec «I’m In Your Hands», véritable shoot de rentre-dedans, elle allie le raw au sugar, c’est assez rare. Elle récidive avec «Let Me Know» qu’elle pulse à l’excellence, elle en swingue chaque syllabe à la science infuse de Sugar Motown, elle roule ça dans sa farine de légendarité au point que le langage s’oblitère, car ça ne s’écrit pas, ça se danse. Elle passe par tous les biseaux, oh oh. Même quand elle fait du sexe avec «Move A Little Closer», elle tient son rang. Elle cultive l’optimum en permanence. Elle opère un grand retour aux Supremes avec le morceau titre - I made up my mind hey-ey - Puis elle rend hommage à l’homme avec «Talkin’ About My Man» - Oh oh he’s so good to me/ I’m talkin’ bout my man - et elle ajoute : «He always pleases me.» Elle attaque son «Dance Children Dance» comme Aretha, elle a le même instinct de Soul Sister et puis voilà qu’elle duette avec Arthur K. Adams sur un «Is That You» dégringolé au heavy sludge de guitar dingling. Tout est solide dans cette compile, on comprend que les Anglais soient tombés amoureux de Mary Love.

La compile Kent Then And Now qui date 1994 fait un peu double emploi avec la précédente, car on y retrouve ses grands numéros de saute au paf («I’m In Your Hands», «Move A Little Closer»), on la revoit battre les Supremes à plates coutures («Let Me Know», «Hey Stoney Face», «Lay This Burden Down», «I’ve Gotta Get You Back»), on la revoit remonter les bretelles de la Soul avec «Satisfied Feeling» et se rapprocher de Dionne la Lionne en explosant «Baby I’ll Come», le tout agrémenté de cuts de diskö funk plus tardifs. On devra se contenter d’un «Mr Man» qu’elle tape au groove de charme, elle y fait du Marvin au féminin. Dans le booklet, on trouve d’autres photos d’elle coiffée en blonde, mais beaucoup plus sexy qu’Etta James. Mary Love paraît heureuse sur scène.
Signé : Cazengler, fort marri
Mary Love. Then And Now. Kent Soul 1994
Mary Love. Lay This Burden Down. The Very Best Of Mary Love. Kent Soul 2014
*
Après l’extérieur, l’intérieur. Après Dylan vu par les autres, voir livraison 548 de la semaine dernière, Dylan par lui-même. Ce n’est pas que celui qui parle a toujours raison, c’est que son témoignage est à verser au dossier de l’inquisition au même titre que tous les autres, avec toutefois cette nuance : l’on n’est toujours trahi que par soi-même.
CHRONIQUES
BOB DYLAN
( Folio 5091 / 2006 )

Le titre anglais est davantage explicatif, Chronicles, Volume one, au moins l’on attend la suite qui n’est pas encore parue. Dylan prend son temps, à quatre-vingt piges passées peut-être veut-il nous faire le coup des Mémoires d’Outre-Tombe à la Chateaubriand. Elles ont toutefois été livrées au public avant sa mort, ce qui nous laisse un peu d’espoir de voir les tomes suivants paraître incessamment sous peu. Je me permets d’évoquer l’immortel créateur de René et Atala car Bob Dylan le cite dans son livre. Question caution littéraire, il est difficile de faire mieux. Que l’évocation de ces mémoires ultra-tombales ne nous induisent pas en erreur : le livre de Dylan n’est en rien une autobiographie. Cela est spécifié dès le titre : chroniques. Ce terme indique un certain détachement vis-à-vis de la réalité existentielle de son propre vécu. Dylan ne se raconte pas, il conte des moments de sa vie. Autant dire qu’il les met en scène soigneusement. Qu’il ne sert de rien de les lire en tant que témoignages d’un passé révolu. La question n’est pas de savoir si l’on peut lui faire confiance, mais de comprendre ce qu’il veut nous signifier par l’écriture d’un tel livre.
NOTES SUR UNE PARTITION
LA TERRE PERDUE

Dès les premières pages Dylan nous induit en erreur. L’histoire commence au commencement de sa carrière, sa signature chez Columbia. Laissez tomber le cursus honorum, trois pages plus loin nous comprenons que c’est un faux départ, repend le récit à la manière de Balzac nous décrivant l’arrivée de Rastignac à Paris. Lui c’est son arrivée à New York, par un temps glacial. La suite est connue, Le Cat Zengler nous a mis en scène (livraison 546) sa première entrevue avec Fred Neil, dans un même ordre d’idée le lecteur se rapportera notre recension du livre de souvenirs de Dave Van Ronk qui corrobore totalement les dires de Dylan. Ce sont des mois d’apprentissage : Dylan arrive à s’intégrer aux principales scènes de la Big Apple folk, loin d’en devenir le challenger irremplaçable, il n’a pas assez d’argent pour louer une chambre, dort sur les canapés chez les amis. L’est toute oreille pour les disques de folk que possèdent ses connaissances, n’approfondit pas uniquement son savoir musical, lit beaucoup, un peu de tout, mais un penchant pour la littérature explore les bibliothèques… Nous parle entre autres de Joe Hill ( voir livraison 324 ) ce qui lui permet de se situer d’une manière, je n’ose pas dire plus précise, car il essaie de n’être ni dupe des puissances politiques, ni de céder au romantisme révolutionnaire qui emportera sa génération. Dévore, apprend, réfléchit… pour ne citer que deux ouvrages, qui apparemment n’ont rien à voir entre eux, si ce n’est qu’ils sont tous deux une réflexion sur la fondation et la destruction d’une civilisation, De la guerre de Clausewitz et La déesse blanche de Robert Graves. Cette première partie nous dresse le portrait d’un Dylan artiste en jeune chien dans un jeu de quilles qui essaie avant tout de garder son self-control. Ne maîtrise pas grand-chose, cependant il revendique l’impression d’avancer pas-à-pas mais sûrement sur l’échiquier du monde qui pour lui se réduit au maigre milieu folk newyorkais.
NEW MORNING

Les narratologues désignent sous les termes d’ellipse narrative le début de ce troisième chapitre qui ne s’inscrit pas dans la suite logique des deux précédents. Après les années de vache enragée, Dylan s’en plaint si peu que nous les qualifierons plutôt de maigres bovidées, l’on espère le glorieux récit des années de vaches grasses. Mais non, pas un mot sur le veau d’or. Ne le tue pas, mais le tait. Passe directement à son fameux et très exagéré accident de moto. Burn out ou ras-le-bol généralisé, l’arrive à Dylan ce qu’a vécu Jean Giono après la parution de ses premiers livres. Ne peut plus être en paix, des visiteurs viennent sans cesse sonner à sa porte. Impossible pour Giono d’écrire ses nouveaux romans. Trouvera la solution en invitant tous ses admirateurs qui attendent de lui un message ultime en les réunissant chaque été durant les années trente dans une ferme perdue dans la campagne, créant ainsi une espèce de première communauté pré-hippie. A la différence près que Giono regroupe autour de lui des intellectuels inquiets de la montée des périls, pris en sandwich entre la fin de la première guerre mondiale et le début de la deuxième qui se profile à l’horizon… A la deuxième différence près que les visiteurs de Dylan sont au mieux de doux utopistes vindicatifs au pire de sombres barges sans gêne ou d’immondes profiteurs. Dylan qui désire vivre tranquillement avec sa femme et ses enfants se verra obligés de déménager à plusieurs reprises pour échapper aux hordes envahissantes…
Explicitement Dylan déclare qu’il ne veut pas être le maître à penser d’une génération d’enfants gâtés ou de simples huluberlus… N’empêche qu’apparaît dans son récit ce que la lecture des chapitres suivants nous incitera à nommer une faille. Le Bob nous déclare que pour couper court à l’enthousiasme soulevé par ses premiers albums il applique une nouvelle stratégie. Celle d’écrire des textes moins forts, douceâtres, vantant les mérites de la vie familiale. Bref il se lance dans le country afin de dégoûter ses fans de la première heure. Avec une pointe de cynisme il ajoute que cela ne l’embarrasse pas trop puisque ces nouveaux albums continuent à bien se vendre… Se détache de plus en plus de ses anciens amis qui aimeraient le voir continuer des discours critiques sur la société. Ne sait pas trop où il va mais sait ce qu’il ne veut plus.
OH MERCY

Nouvelle ellipse temporelle. Bien plus gênante que la précédente. En plus de sauter quelques années, notre héros tait sa conversion. Faut lire avec attention le texte pour l’entendre déclarer à demi-mot, sans s car il n’en prononce qu’un, juste une onomatopée, qu’il ne nie pas l’existence de Dieu. L’est vrai que son enthousiasme s’est dilué en une dizaine d’années… Mais il révèle quelque chose de bien plus grave qu’il cachait dans la partie précédente. Se plaignait de n’avoir pas le temps, à cause des intrus qui assiégeaient sa maison, d’écrire, affirmait aussi, répétons-le, qu’il refilait des textes faiblards pour avoir la paix… ce coup-ci il lâche le morceau, n’y arrive plus, il a perdu le truc, ne pond que des textes de qualité bien moindre. Nous entrons dans les pages les plus ennuyantes. Nous donne tous les détails, heures, lieu, circonstances de tous les nouveaux textes pas trop mauvais qu’il parvient au prix de grandes difficultés à collationner pour le futur album Oh Merci. Ce n’est pas tout. Après les affres de la création littéraires nous assistons morceau par morceau à l’enregistrement du disque. N’est plus capable d’enregistrer en une séance de quelques heures trois, quatre, titres pratiquement en une seule prise. Pour Oh Merci lui faudra trois mois. Longue parturience. Couvre d’éloges son producteur Daniel Lanois. Le lecteur s’ennuie ferme. Dylan nous fait part de ces états d’âme, de ces coups de blues, de son malaise existentiel. Est content du résultat final, mais selon lui le disque ne trouve pas ses acheteurs.
FLEUVE DE GLACE
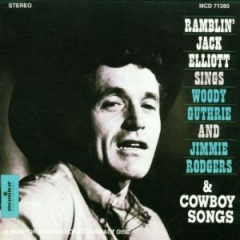
Retour en arrière, le récit reprend là où s’achevaient les deux premières parties. Mais l’angle d’attaque est différent. Trace non plus les lentes avancées, les sauts de puce, qui centimètre après centimètre lui ont permis d’avancer dans la carrière. Nous délivre son itinéraire intellectuel. Certes il progresse, peut louer un minuscule appartement, Autant il est resté très discret quant à ses petites copines, autant il s’attarde sur Suze Rotolo, lui qui déclare que l’homme politique qu’il préfère est Barry Goldwater ( ultra-droite conservatrice) est quelque peu incliné par Suzie vers de généraux idéaux de gauche. Cet aspect politique n’est que l’écume de sa problématique. Il est venu du fin-fond de son Minnesota à New York avec une seule idée en tête : rencontrer et devenir le nouveau Woody Guthrie. Ne se prive jamais d’inclure un ou plusieurs titres de Guthrie dès qu’il a l’occasion de monter sur scène. Woody lui semble insurpassable. Jusqu’au jour où Jon Pankake, amateur émérite de folk lui brise son rêve. Tu ne chanteras jamais aussi bien que Guthrie. Cette phrase destructrice est suivie d’une autre qui l’atomise : Jack Elliot que tu n’as jamais entendu le chante mieux que toi. L’écoute des disques est sans appel, non seulement Elliot le chante mieux que Dylan mais ses interprétations sont la preuve qu’il a compris, assimilé et ce faisant dépassé le maître. Désormais le brave Bobby change son fusil d’épaule, il ne chante que du Ramblin’ Jack Elliot… D’ornière en ornière… Dylan va enfin comprendre que ce qui lui manque, c’est l’écriture de textes qui ne doivent rien à personne, ni à Guthrie, ni à Ness, ni à quiconque. En l’initiant à la peinture et au dessin Suze lui permet d’avancer dans sa tête, il dessine mal mais il dessine selon son propre point de vue, il reproduit un objet comme nul autre ne l’appréhende. Maintenant il sait se poser dans le monde. Ne lui reste plus qu’à entrer en osmose avec des œuvres engendrées par cette méthode. Trouve deux modèles qu’il décortique soigneusement pour savoir comment l’on écrit. Rencontre le premier encore grâce à Suze qui travaille à Broadway, un parolier Bertold Bretch, un compositeur Kurt Weill – vous connaissez, rappelez-vous sur le premier disque des Doors Alabama Song ‘’ Show me the way to the next whisky bar…’’ , Dylan comprend comment on écrit un texte, ne pas vouloir tout dire, laisser les mots s’appeler les uns les autres pour insuffler sens et mystère au texte, le deuxième sera Robert Johnson que Columbia s’apprête à rééditer, des mots simples mais la ligne mélodique qui s’éparpille en mille droites qui s’écartent l’une de l’autre pour mieux faire resplendir le centre générateur. Dylan a tout compris. Il est prêt à être le grand Dylan.
Ce que révèleront le ou les volumes postérieurs nous ne le savons pas mais cette dernière partie du volume 1 nous aide à comprendre le sujet du livre. Ce n’est pas une histoire qui narre les débuts incertains d’un individu destiné à devenir l’un des plus grands chanteurs de sa génération. Dylan ne cherche pas à nous décrire son chemin vers les étoiles. Ce n’est pas l’apothéose qui le tente. Se penche sur la dimension littéraire de son écriture. Tente de percer son propre secret. Au bout d’un moment les textes couleront de sa plume pratiquement tout seul. Pourquoi ? Comment ?

L’on pense à Paul Valéry qui après quatre années difficiles à composer La jeune Parque est le premier étonné, pour ne pas dire sidéré, de la vitesse à laquelle il écrit la plupart des poèmes de Charmes. Même phénomène chez Rilke qui durant dix ans reste aux aguets de la venue des Elégies à Duino, dans l’angoisse et la douleur, et qui écrit avec une révoltante virtuosité Les sonnets à Orphée en quelques jours. Certes il existe une différence essentielle entre les deux poëtes et Bob Dylan, tous deux sont à l’acmé de leur fructuation créatrice de laquelle jaillira leur accomplissement poétique. Il leur aura fallu toute une vie d’écriture, de réflexion, de méditation et de travail acharné pour livrer leurs œuvres majeures, Bob Dylan est au début de son efflorescence lorsqu’il délivre ses textes les plus novateurs. Comme par hasard un évènement déclenchera le processus. La lecture de Rimbaud. Il regrette de ne l’avoir pas connu auparavant, cela lui aurait permis de gagner du temps.
Rimbaud se remettra-t-il vraiment de ses cinq années fulgurantes. Il est obligé de se renier et de s’enfuir à l’autre bout de la terre, de se livrer à la prosaïque fonction de commerçant… Si l’on relit la trajectoire de Dylan à l’aune de Rimbaud, l’écriture de ce premier volume des Chroniques prend toute sa signification. Rimbaud part en Abyssinie et interrompt tout contact avec le milieu poétique, Dylan continuera sa tâche de chanteur. Il ne sait pas rompre définitivement. L’intitulé de son Never Ending Tour, ainsi le baptise-t-il, est assez éloquent… Dans ses Chroniques, Dylan retrace la généalogie du rassemblement des différents éléments qui lui ont permis de devenir le grand Dylan, un peu comme un alchimiste qui dans sa jeunesse a réussi à transformer le vil plomb en or et qui n’y parvenant plus essaie de retrouver la recette qu’il est incapable de refaire… Un terrible aveu d’impuissance quand on y pense. Un livre poignant.
Damie Chad.
AGREUS
GOATGOD
( Mars 2022 / BC -YT )
Goatgod vient de Grèce, de Thessalonique, ville portuaire au nord de la Grèce, dans sa partie macédonienne. Le groupe adepte du Do It Yourself en 2020, a commencé à enregistrer en 2021. Le groupe est formé à partir de deux autres formations : Samatas et Disurband. Est-ce cette réunion qui les a emmenés à s’accorder sur le nom de leur album Agreus,
Xanthos V : guitares, basse / Theodosis V : drums / Sotos Ag : vocals.
Les amateurs de batterie ne manqueront pas de visualiser les cinq vidéos de démonstration du travail de Sotos Ag sur ses fûts.

Awakening : emballement de batterie, une voix qui envoie les mots comme des boulets de canon, et derrière une symphonie de cordes qui recouvre le monde entier d’un flot majestueux, parfois à mi-voix un écho lointain répète les lyrics, break étourdissant, le chant se transforme en injonction tumultueuse, un appel à la résistance, à la renaissance, à s’amalgamer à la puissance d’un Dieu. Poisoned by guilt : rythme binaire qui n’empêche pas des éructations démoniaques, le vocal n’est plus que cris de haines, exhortations à se surpasser et objurgations à se délivrer des fausses culpabilités, il est temps de s’arracher à la religion de la bible, de se retrouver, de prendre son destin en main, Dieu est mort, éruptions souterraines de tambours, le message est asséné avec tant de force et une si féroce clarté qu’il se présente sous forme d’une déclaration de guerre à l’avilissement de la psyché humaine. Enligthenment : soleil, embrasement de guitares, subite dégoulinade, rythmique précipitée, vocal à l’emporte-pièce, pas encore au bout du tunnel, comprendre l’ampleur du désastre est une chose, se diriger dans les ténèbres de sa perdition, réaliser en soi ce désir de clarté s’avère d’ une toute autre difficulté, regardons le soleil, il est la force, l’énergie primitive, les guitares planent maintenant dans l’Empyrée, au-delà de l’astre c’est le char d’Apollon qui apparaît en filigrane, souffles divins, un enthousiasme sacré s’empare de moi. Culmination. Bucolic outbreak : ambiance virgilienne, irisation acoustique qui tourne vite en une ronde sauvage, la joie est d’autant plus forte qu’elle repose sur la présence de la mort, il faut la dépasser, l’admettre en tant que simple séquence d’un cycle naturel, la batterie va de l’avant mais les guitares tournent sur elles-mêmes à l’image de la nature qui semble avancer vers sa disparition pour mieux renaître. Return of the heathens : florilèges de guitares, vocal hurlé, les païens sont de retour, condamnation du vieux monde, de l’asservissement intellectuel par la peur de l’obscurité, curieuses montées de splendeurs entrecoupées de dissonances grondeuses, le rythme s’alourdit, ralentit, reprend sous forme de poussées germinatives, il n’est pas facile de débarrasser l’esprit humain de l’ivraie des religions, le morceau se termine en apothéose. Ejaculation of a cruel god : grincements insupportables, ce n’est jamais gagné, les guitares en sirènes d’avertissements, batterie implacable, il est si facile de retomber dans l’ornière, de retourner vers les chaînes de l’esclavage religieux, vocal ralenti, hurlé, jusqu’à ce qu’une rythmique folle signifie que vous êtes happé par votre propre déchéance. The Delphic oracle : avancée processionnaire, le rythme reste lourd et lent même s’il est dynamité par des brusqueries de batterie, nous voici au cœur du paganisme, dans l’antre de Delphes, la prêtresse sur son tabouret attend que l’esprit d’Apollon se mêle à elle, emplisse le vase vide de son cerveau, vocal surexcité, instrumentation saisie de vertige, la pythie est en transe, le moment de l’interroger est venu, le passé irradie sa vision et les guitares s’étendent à l’infini, l’instant crucial, chœurs à l’horizon interne, la réponse est dans la question, quand enfin ce monde de ténèbres se terminera-t-il. Le texte est moins naïf qu’il n’y paraît. Le désir n’est pas la réalité. Embrace the nymph : nocturne crépusculaire, voici la réponse attendue, ambigüe comme il se doit, embrasser la nymphe, la compréhension est des plus simples pour les esprits peu aiguisés, elle se résoudra à se saisir d’un corps de femme, mais il faut choisir, ou tu t’allies à la chair féminine de la réalité, ou tu vis l’acte d’accouplement selon la réalité du mythe. Il faut choisir entre la rugosité charnelle de l’être humain et la confrontation intérieure avec le feu impérieux de la puissance divine, le morceau monte et descend, tantôt fièvre sexuelle, tantôt outrance extatique, c’est dans la brûlure que se conçoivent les demi-dieux et les mythes. Que se construit l’arc-en-ciel qui ne permet pas de rejoindre l’immortalité. The summoning night of Pan : la nuit de Pan que vous ne confondrez pas avec l’obscurité du Walpurgis faustien, nous sommes à l’équinoxe du printemps, les guitares ronflent telles les rhombes des joyeux cortèges, le son se disloque tandis que par-dessous se profile une nouvelle ligne harmonique, entrons doucement dans danse, entrons doucement dans la transe, nous ne sommes pas pressés mais le rythme s’accélère, la panique sacrée s’immisce en nous, c’est ainsi que l’on se sépare de soi et que notre esprit monte en spirale vers les demeures de l’Olympe telle la fumée des sacrifices, il s’agit dans notre éructation charnelle de faire fondre notre chair mortelle à ce brasier qui nous brûle de l’intérieur, les rhombes vrombissent quand tout s’apaise, mais maintenant nous savons que le Dieu Pan n’est pas mort, l’anglais n’est plus de mise, les dernières paroles sont en grec, l’hymne chante l’unité des cieux, de la mer, des océans et des abysses transformés en une énergie pure par une joie inhumaine.
Ce premier opus est splendide.

Nous n’avons pas encore regardé la pochette. La symbolique est claire : à l’officiant d’une liturgie chrétienne les mains benoîtement croisées sur le ventre en guise d’obéissance se substituent le squelette – symbole de la libre acceptation de la mort et refus de la croyance en un autre monde paradisiaque, amor fati dirait Nietzsche - et la tête du bouc Pan, les bras levés, la paume des mains tournées vers l’ouranos. Le lecteur visualisera le médaillon frappé du delta de Zeus et sa représentation rayonnante en Sol Invictus.
Le dieu chèvre n’est pas à confondre avec le bouc qui préside aux messes sataniques qui firent fureur sous le règne de Louis XIV. L’anti-christianisme satanique, même inversé n’est que du christianisme. Ici les lyrics sont empreints d’une philosophie nietzschéenne, qui condamne le christianisme en tant que religion, parce que toute religion est croyance et donc asservissement de la pensée philosophique. L’imagerie polythéique est à entendre comme une symbolisation conceptuelle historiale et élémentale. Elle pose l’univers en tant que fragments entremêlés mais dépourvus de tout désir d’agrégation unitaire ce qui logiquement préside à l’élaboration d’une pensée dégagée de tout obscurantisme religieux. Politiquement, nous sommes dans l’impensé métaphysique de l’anarchie.
Damie Chad.
JIM MORRISON, LE FLOU L’EMPORTE
MARIE DESJARDINS
(Série Portraits Rock, in Presse Profession Spectacle)

Magnifique article sur Jim Morrison écrit par Marie Desjardins. Aussi beau qu’une nouvelle de Villiers de L’Isle Adam. Le grand art, raconter une histoire dont on connaît tous les éléments et attiser les braises chaudes d’une blessure poétique qui ne se refermera jamais. Ouverte pour les siècles à venir, tel l’itinéraire de Rimbaud. A cette différence près que la trajectoire de Rimbaud reste celle d’un solitaire alors que Morrison fut non pas un personnage public, mais un phénomène générationnel autrement dit un moment très particulier, une coupure dans l’histoire de l’imaginaire du monde. Comme Platon nous l’a appris, nous ne voyons du monde que des ombres, nous y sommes habitués, toutefois l’ombre de Jim Morrison est plus sombre que les autres. Elle resplendit d’une noire luminosité qui éblouit et qui n’est pas sans renvoyer aux recherches de Goethe sur la manifestation des couleurs.
Marie Desjardins rebat les cartes. Une centaine de lignes lui suffisent pour exposer les arcanes majeurs du tarot de la destinée. Toutes les figures sont convoquées, Morrison le clochard céleste, Morrison diapré de beauté apollinienne, Morrison le poëte, le double jeu des dames essentielles, Patricia désirée et Pamela aimée, mais aussi les comparses de la dernière soirée, Sam Bernett, Marianne Faithfull, les fantômes d’Elvis Presley, de Gene Vincent, de Shelley, Michel Embareck et jusqu’à nos Chroniques de pourpre… si Morrison fut un aède à la voix d’airain qui résonne encore, il fut aussi un homme de mots, cette cendre noire qui recouvre, enfouit, protège, et préserve de l’oubli rongeur le souvenir des existences chaotiques et volcaniques dont on retrouve les traces érotiques, arestiques et éristiques dans de mémorielles villas pompéiennes des Mystères, ouvertes à tous vents, qu’elles abandonnent en ultime témoignage derrière elles. Tout réside dans le mystère des choses qui n’existent plus mais qui ont eu lieu. Nous ne sommes que des archéologues à la recherche des cités disparues dont on ignore les emplacements.
En diabolique illusionniste Marie Desjardin recompose le jeu de perles brisées de Morrison. Un incroyable tour de passe-passe, elle joue le rôle de Méphisto ressuscitant pour obéir à Faust le fantôme d’Hélène de Troie, lui ordonnant pour cela de repasser la porte des Enfers, ce porche obscur de toute existence humaine… Las, elle laisse couler à terre, de la paume de son évocation, entre les doigts de ses mots, le sable des verroteries irisées, et tout s’efface. Cruauté de la littérature ! Elle nous a permis d’être le temps d’une lecture des voyants alchimiques et nous ne sommes plus que des voyeurs dépités.
Seule l’aile brisée d’un ange rilkéen sépare le fou et le flou.
Damie Chad.